|
Azyl Killer ou :
je veux seulement filmer l’amour
| |
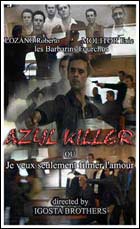 |
|
|
Réalisé par
les " Igosta Brothers ", tourné
pendant un an et demi selon les disponibilités de ces
comédiens d’occasion, Azyl Killer suit le parcours
d’un réfugié contraint de frayer avec la mafia
russe pour pouvoir s’installer, et réaliser sa vocation
de cinéaste. Influencés par le Guy Ritchie d’Arnaque,
Crime et Botanique, dont ils réitèrent la
fascination pour les effets cinétiques, les frères
Igosta s’appuient sur un comédien (il est en fait musicien)
remarquable, dont la capacité burlesque appelle d’autres
rôles. Les séquences les plus cohérentes,
qui prennent place dans le décor original d’un centre
d’accueil pour immigrés, ouvrent et ferment le film.
Au milieu, cela tient plus de la succession de sketchs sur
le thème du " tueur malgré lui ".
Le tournage fragmentaire se fait sentir, mais recèle
quand même de très bonnes idées (les soudaines
immersions du personnage dans son rêve, au beau milieu
d’une fusillade). Au final, la jubilation devant la galerie
de seconds couteaux qu’épingle le film minore son manque
de cohérence.
Teflon
de Barry Nathan (Suède)
Se focalisant sur un rêveur
anonyme, fantasmant sur une jeune femme croisée dans
le métro chaque jour, Teflon rejoue le thème
de l’incommunicabilité, cette fois dans une absence
quasi-autistique. En inscrivant sa mise en scène dans
des espaces intermédiaires clos (le métro, une
station de radio), Teflon offre un remarquable travail
sur la couleur, qui semble imprégner le corps même
de l’image, comme si l’emprise du réel " déteignait "
sur tout. Cette couleur engluante opère dans un renversement
de valeurs qui travaille l’idée reçue du rêve
comme échappatoire ( on pense au " Sleep "
du Big Brother de Georges Orwell). La rêverie érotique,
colonisée par la pornographie, n’est plus un espace
de libération, mais rejoint un réel donné
comme somnambulique. Dès lors, le refus de la jeune
femme d’enregistrer le décompte de l’horloge parlante,
apparaît comme un acte de révolte dont l’éphémère
ne pèse pas lourd face à la torpeur fantasmatique
du réel décrite par Teflon.
Paris 2000,
Année du Dragon,
de Perla Tucillo et Nicolas Billy
…Ou la nuit de travail d’un
chauffeur de taxi asiatique. Ce court film (5’) à la
lisière du fantastique use du thème du double
pour donner à voir le travailleur (clandestin ?)
comme absent à lui-même. Les trajets en voiture,
la nuit, s’offrent dans un beau n&b qui évite le
cliché de la ville " infernale "
(Taxi Driver), au profit d’une image délicate
et morbide. Avec une sorte d’ironie noire, en creux, Paris
2000, Année du Dragon travaille d’autre part le
préjugé des asiatiques " tous identiques "
en s’attardant sur le peu de choses qui différencient
un homme d’un autre (une photo, une mélodie), signes
futiles d’une existence.
Maloriage,
de Antoine Moreau
Maloriage
s’inscrit dans les codes du film noir, avec son personnage
de " femme fatale " séduisant son
voisin fermier afin qu’il assassine son salaud de mari. Mais
ce film nantais, terre de l’art vidéo rigolo (Pierrick
Sorin, pour n’en citer qu’un), part du drame campagnard, et
de sa thématique de lutte des classes fleurant bon
la qualité française, pour mieux le détourner.
Placé sous la double influence de Russ Meyer (les grosses
poitrines en moins) pour son cynisme, et des Deschiens pour
l’attachement maniaque au kitsch, Antoine Moreau réalise
un film théâtral, de très mauvais goût,
mais paradoxalement très drôle. La chute finale,
décevante, minore cependant l’attention portée
à la création d’un univers original, en rabattant
le film sur l’onirisme. Une dernière citation (Le
Magicien d’Oz ?) de trop.
|