Eloy de la Iglesia
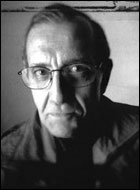 |
|
|
|
Il aura fallu attendre sept
ans pour que cet hommage voit le jour, nous fut-il répété
avant chacun des films du cinéaste espagnol. A les voir, l’hommage
rendu s’impose comme une évidence, tant certaines de ses œuvres
participent pleinement d’un cinéma des années 70-80, parallèle
à la modernité cinématographique identifiée, et qu’il devient
urgent de redécouvrir afin de dépasser la fixation « bis »
et ses déviances psychotroniques. « Modernes » par
leur sujet, soucieux de l’actualité de leurs temps, les films
de Iglesia appartiennent à cette catégorie d’œuvres « inclassables »
qui parsemèrent les années 70 : elles s’inscrivent a
priori dans la continuité d’une écriture classique, mais en
en exacerbant ses composantes majeures, notablement l’identification
du spectateur à la réalité diégétique, et l’identification
au personnage. Le travail sur des réalités interlopes, marginales,
ou plus globalement closes sur elles, constitue leur champ
d’action, là peut s’y développer ce qui constitue le point
d’incandescence de ces œuvres éparses : l’irréductible
corps classique. Cria Cuervos de Carlos Saura, quelques
Polanski (Répulsion), La raison du plus fort de
R.W. Fassbinder, pour ne citer qu’eux, invente une nouvelle
manière d’en passer par un corps d’acteur pour exprimer les
bouleversements du réel.
Auteur d’une poignée de films incandescents, brûlant d’une
même passion érotique et politique, Eloy de la Iglesia apparaît
comme une exception dans le contexte d’un cinéma espagnol
ou cinéma « d’auteurs » et de genre ne se mélange
pas. De La semaine d’un assassin à L’Enfer de la
Drogue, c’est à une plongée dans le dérèglement du corps
qui ne se refusent jamais le recours à l’image spectaculaire
que nous invite ce cinéaste encore méconnu. De son travail,
nous nous attarderons sur quelques films.
| |
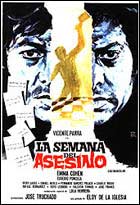 |
|
|
Tout d’abord La Semaine
d’un Assassin (La Semana del Asesino, 1972) s’offre
en pendant masculin et prolétaire de Répulsion. En
effet si les sources d’aliénation sont différentes, les conséquences
sont identiques : le basculement psychotique et le meurtre,
dès lors qu’un événement imprévu bouscule l’équilibre précaire
d’un quotidien routinier. Faisant preuve d’une grande minutie
dans la description du détail sordide, La Semaine (…)
pêche cependant lourdement par des invraisemblances grossières
de scénario. C’est surtout dans la mise en place d’un amour
impossible entre le tueur ouvrier et un bel écrivain homosexuel
que Iglesia emporte l’adhésion du spectateur, parvenant à
dépasser l’énormité de son propos (psychopathe et homosexuel,
même combat face à l’oppression) par un sentimentalisme rendu
possible par l’écrin d’ordure qui l’enchâsse.
L’Enfer de la drogue (titre d’importation on ne peut plus
« bis » pour rebaptiser ce sobre El Pico) fut le
plus gros succès public de Iglesia, et engendra une suite
( El Pico 2 , n’est-ce pas). Réalisé en 1983, El Pico s’attache
à la dérive de deux adolescents drogués, qui les conduira
à l’irrémédiable du meurtre. La finesse de El Pico réside
dans l’absence d’explication du basculement dans la drogue
de ces deux jeunes garçons d’un milieu aisé, entourés de parents
aimants et attentifs. La drogue fait partie de leur univers,
au même titre que les repas de famille et les sorties entre
amis. Dès lors, et bien que des explications possibles soient
dégagées (un père trop possessif, des mauvaises fréquentations),
c’est en choisissant de s’en tenir à une sorte d’évidence
du caractère vital de l’addiction que Iglesia souligne le
dérèglement d’une jeunesse abandonnée à la laideur du monde.
El Pico est proche en cela d’un film comme Spetters de Paul
Verhoeven, lui aussi fasciné par la marginalité forcée de
jeunes aux désirs désordonnés. En comparaison de son collègue
néerlandais, Iglesia perd en puissance épique ce qu’il gagne
dans la description sans pathos d’un processus inexorable
de décomposition : celle d’une société patriarcale trop
occupée à ses propres combats, sans comprendre pour autant
ses héritiers. Avec une roublardise qui explique peut-être
le succès populaire du film, c’est en se penchant sur le cas
du fils de gendarme que Iglesia met à nu avec une justesse
émouvante la qualité si particulière de l’amour paternel,
ce serpent de mer du cinéma. El Pico se clôt dès lors naturellement
sur un renoncement, celui du père, dans la séquence la plus
poignante vue à ce festival.
|