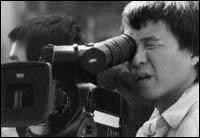 |
|
|
|
Charles Tesson se réjouit
de voir un public si vaste, annonçant qu'un symposium Jean
Renoir à Paris n'attirerait sûrement pas une telle foule.
Ses observations rejoindront celles de Pedro Costa; Ozu est
un cinéaste que l'Europe découvre dans les années 70; d'une
part on reconnaît le maître, d'autre part, le climat socio-politique
de l'époque rend difficile d'accepter l'œuvre dans sa totalité,
la famille étant durant ces années un obstacle majeur à franchir,
à transformer, en tant qu'incarnation d'une société appelée
a sa destruction. Enfin, on touche à un débat possible, qui
sera vite éteint par les modérateurs. Il reprendra aussi l'observation
de Kiju Yoshida, sur la position militaire d'Ozu: dans les
années trente, Ozu tournait souvent à Ginza, période à laquelle
les militaires étaient présents sur toutes les rues. Or, pas
un seul uniforme, jamais, dans les films d'Ozu de cette période.
Kiju Yoshida faisait cette remarque en rappelant que le Premier
ministre Junichiro Koizumi s'apprêtait à envoyer en Irak 1000
hommes des Forces de Défense du Japon, décision contestée
par la majorité des citoyens japonais, cela trois jours avant
ces images de Saddam capturé. Tesson reviendra enfin sur une
autre thèse de Yoshida, évoquée par Manoel de Oliveira, autour
de la séquence à la fin de Printemps Tardif, lorsque
Setsuko Hara et Chishu Ryu, fille et père, font un dernier
voyage ensemble avant le mariage de celle-ci, et qu'elle lui
avoue vouloir rester avec lui, s'occuper de lui, voilà son
bonheur. Yoshida y voyait l'inceste. Nous y reviendrons. Bref,
Tesson cherche le dialogue, mais Hasumi laisse peu de marge
pour manœuvrer. Ce sera Hou Hsiao Hsien qui arrivera, à la
toute fin, à donner un peu de vie à ce qui se transformait
en « séance ».
Le critique Coréen, Lim Jae-Cheol, s'exprimant lui aussi difficilement
en anglais, qui organisa la première rétrospective Ozu en
Corée, rappelle la situation politique, les conditions de
réception du cinéma japonais en Corée, longtemps interdit
de distribution et diffusion. Les portes commencèrent à s'ouvrir
à la toute fin des années 90, et l'on peut compter aisément
le nombre de films japonais exportés vers la Corée. Les feuilletons
télé japonais en revanche ne rencontrent pas cette forme d'interdit.
Comment parler d'Ozu en Corée ? En balayant l'enjeu national.
Ozu est un immense cinéaste, un maître, discutons de son œuvre
sans évoquer le Japon : la forme, la construction, la structure,
les thèmes... mais pas de Japon. M.Hasumi, lui-même organisateur
de rétrospectives Seijun Suzuki à Locarno et Kato Tai à San
Sebastian (signe que de l'étranger, il n'y aurait qu'un seul
critique et théoricien au Japon), demandera en conclusion
à Lim Jae-Cheol quel fut l’accueil de ces mêmes cinéastes
culte en Corée, qui firent l'objet d'une autre rétrospective
montée par M.Jae-Cheol. Cette fois c'était plus simple, les
films de Suzuki et Tai ne sont même pas considérés comme des
films, mais comme des objets de la pop culture japonaise,
ce que l'Etat admet, ne voyant rien de politique chez Suzuki
et Tai !
|