| |
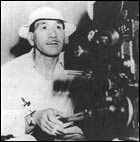 |
|
|
Mais le clou du symposium,
c'est la dernière intervention de Chris Fujiwara. Critique
/ théoricien qui monte en Amérique, ce « Japanese-American »,
dont les grands-parents immigrèrent du Japon aux USA dans
les années 10, découvrait lui aussi ce pays pour la première
fois, bien que le cinéma l'avait beaucoup aidé a comprendre
le Japon, surtout ceux d'Ozu. Puisque M.Hasumi n'avait ni
daigné ou ni trouvé de critiques japonais de la même génération
que Fujiwara, celui-ci allait devoir porter deux casquettes.
Tâche impossible. Cela dit, rappelons que figuraient aussi
durant ces deux journées Kiyoshi Kurosawa et Shinji Aoyama,
qui suivirent les cours et conférences de M.Hasumi, qu'ils
collaborèrent tous ensemble à l'édition des Cahiers du Cinéma
Japon, que les seuls critiques Français invités étaient des
Cahiers, que Hasumi lui-même avait écrit dans un numéro des
Cahiers, à Paris, un petit texte sur le film - hommage que
tournait Hou Hsiao Hsien à Tokyo, dans lequel il jouait un
rôle de figuration... On continue ? Chris Fujiwara avait publié
un livre sur/sous-théorique sur Jacques Tourneur, à l'image
d'ailleurs du livre de Shigehiko Hasumi sur Ozu, des ouvrages
au regard minutieux, précis, mais dont les thèses, les enjeux
théoriques peinent à convaincre. Fujiwara, de toute évidence,
ne maîtrise pas Skorecki... Mais son discours se situe ailleurs,
davantage dans une démarche qui rappelle celle de Kent Jones,
et donc forcément Martin Scorsese, celle d'un passeur, d'un
guide inspiré. Fujiwara, pour remercier son hôte, s'arrêtera
sur l'évolution de la pensée de Hasumi à l'égard d'Ozu. Tout
d'abord la représentation pure d'un cinéma japonais, à travers
les chapitres consacrés à la maison japonaise, l'escalier
séparant les étages, puis aux repas qui distinguent les personnages,
tofu et porc panné, Hasumi en venant à dire qu'il était peut-être
le moins japonais de tous les grands maîtres, à la lumière
de l'impact international de son œuvre, ce que confirmaient
les cinéastes étrangers.
Le cinéaste Shinichiro Sawai s'était longuement arrêté sur
le découpage chez Ozu, le champ contre champ, raccords qui
ne sont pas dans l'axe, etc. Fujiwara y revient, en haussant
la mise, stratégie très prisée par les collègues Américains
lors de colloques. Selon lui, Ozu est non seulement le moins
Japonais des grands réalisateurs, mais aussi le moins universel
car toute son esthétique porte les traces de l'étrange, d'une
fausse symétrie, de déséquilibres subtils qui rendent ses
films inquiétants. Fujiwara l'avoue : Ozu fait peur ! Enfin,
il quittera la scène en offrant qu'il se souviendra de Tokyo
comme de la ville où les gens aiment Ozu. En voila un qui
n'est pas venu pour rien.
|