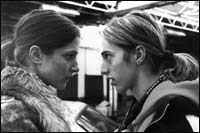 |
|
|
|
Commençons justement par les films
des Balkans et tout d’abord au gagnant du prix Fipresci,
Summer in the golden Valley du bosniaque Srdban Vuletic.
Ce sombre polar social urbain, situé en plein cœur de Sarajevo,
séduit par la nervosité quasi américaine de sa mise en scène,
l’efficacité du récit, sa violence désespérée, et le tempérament
excessif, très balkanique, des personnages. On est aussi
frappé par le climat très sombre, pessimiste, voire nihiliste
du film. La Bosnie d’après guère que nous dépeint Vultic
apparaît comme un monde en proie au chaos, à la confusion
généralisée des valeurs, où des flics simulent des enlèvements,
où priment les rapports de force et où seule compte la loi
du fric. Le film raconte l’histoire, assez dérangeante,
d’un jeune garçon qui perd son innocence en se confrontant
à la cruelle réalité du monde. Mais le film échappe au nihilisme
absolu en ce sens que le jeune héros garde en lui un espoir
et découvre une valeur plus important que l’argent.
A en juger par les trois films de la sélection bulgare,
on ne peut pas dire que ce cinéma, encore très fragile,
ait encore atteint un niveau très satisfaisant. Il y a un
manque évident de moyens, mais on sent aussi que certains
films sont prisonniers de vieilles méthodes de conception
et réalisation datant de l’ancien système. C’est par exemple
le cas de Journey to Jerusalem du vétéran
Ivan Nichev : cette chronique historique, entre drame
et comédie, d’une famille juive qui fuit le nazisme pour
rejoindre la Palestine et atterrit en Bulgarie, souffrait
d’une mise en scène poussive, figée et vieillotte. Crazy
Day, d’une jeune réalisatrice de 28ans, réunissait tous
les défauts du film d’étudiant : sage et appliqué à
l’extrême. Cette chronique de la relation entre une jeune
femme artiste et son grand père pittoresque se voulait tendre
et douce amère mais se révélait d’une grande platitude et
mièvrerie. Le seul film intéressant était Mila From Mars,
réalisé également par une jeune femme. Malgré un côté maladroit
et bancal, parfois amateur, ce film, à l’opposé du précédent,
témoignait d’une réelle invention et audace dans sa mise
en scène : montage heurté et nerveux, cadrages de travers
etc. ; la réalisatrice, peu soucieuse des règles, privilégie
une certaine déconstruction au bénéfice de l’énergie et
du rythme.
| |
 |
|
|
Maria du roumain Peter Calin
Netzer, est un mélo social comme on n’ose plus en faire
et est représentatif d’une certaine production roumaine
qui apparemment ne parvient pas à se sortir d’une inspiration
et de schémas datés. C’est l’histoire d’une mère de huit
enfants, marié à un chômeur alcoolique qui la bat et l’abandonne,
obligée de se prostituer pour survivre. Bref, le film convoque
tous les poncifs du genre et au lieu d’émouvoir agace par
sa tendance à accumuler les malheurs, qui s’avère lourde
et démonstrative, comme au bon vieux temps du réalisme socialiste.