 |
|
|
|
Durant les trois mois et demi passés
chez David, la simple existence de ce nouveau projet de
long métrage aurait probablement justifié
à elle seule que je fasse un
pieux pèlerinage
sur les traces de ce film alors virtuel, ce que je mis à
exécution dès la semaine de relâche
de Noël 1995. D'autres prétextes se présentèrent
comme une évidence pour explorer les lacets de Mulholland
Drive. En premier lieu, le Crow's Nest où je séjournais
était perché à flanc de colline, à
quelques mètres en contrebas de cette fameuse avenue.
Cette proximité avec sa propriété a
sans doute constitué une source d'inspiration non
négligeable pour David : bien que Mulholland
Drive serpente sur près de cent kilomètres,
une série de plans sur des panneaux indicateurs (notamment
celui de Franklin Av.) dans les séquences initiales
du film démontrent que l'action se déroule
dans les environs immédiats de la demeure où
il réside, ce qui n'est pas sans rappeler la genèse
de
Lost Highway, où la maison des Madison
était voisine de la sienne. Si j'ignorais évidemment
ces détails en 1995, je savais par contre que, au
terme d'un des nombreux virages qui rythmeraient ma marche,
Mulholland Drive me conduirait rapidement au Hollywood Bowl
Overlook
(7)
qui, comme son nom l'indique, offre une impressionnante
vue panoramique d'une grande partie de Los Angeles, des
hauts buildings de Downtown aux riches zones résidentielles
de Beverly Hills en passant par les collines verdoyantes
d'un parc naturel sur lequel je reviendrai d'ici quelques
instants. C'est également depuis cet observatoire
privilégié que je pus observer pour la première
fois un des
monuments incontournables d'Hollywood
devant lequel pourrait s'extasier Betty, le personnage principal
de
Mulholland Drive, tout comme des millions de spectateurs
à travers le monde : les célébrissimes
lettres géantes du Hollywood Sign…
Par la suite, le tournage de Lost Highway
me ramena à Mulholland Drive : la mémorable
séquence du tailgater, durant laquelle Mr.
Eddy, très à cheval sur les principes, assène
un cours particulier percutant à un chauffard qui
n'a pas suffisamment respecté à son goût
les règles de base du code de la route, était
en effet censée se dérouler sur cette avenue,
comme le stipulait le scénario. Or, probablement
parce que Mulholland Drive est très fréquentée
durant la journée, la production se rabattit pour
le tournage sur une voie relativement déserte mais
présentant pourtant des similitudes frappantes avec
l'avenue hollywoodienne : une route extrêmement contournée
qui dévale le long des collines de Griffith Park,
immense parc naturel qui se déploie au nord-est d'Hollywood.
Pour les mêmes raisons, nous pouvons d'ailleurs facilement
imaginer, même si rien ne permet de l'affirmer indubitablement,
que la séquence initiale de Mulholland Drive
a de nouveau pu être tournée à Griffith
Park, tant les lacets que l'on y entrevoit me paraissent
proches de l'image que j'en ai conservée dans mes
souvenirs. (Dans un entretien accordé au magazine
Studio, David a cependant récemment affirmé
que la séquence en question avait bel et bien été
tournée sur Mulholland Drive, entre Outpost Drive
et le Hollywood Bowl Observatory.)
| |
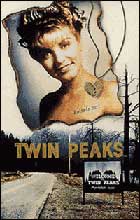 |
|
|
Aujourd'hui, lorsque David fait remonter
la source de Mulholland Drive à 1990, il souligne
en fait simplement l'attrait séduisant qu'avait su
exercer sur lui le nom de cette route hollywoodienne. Il
entreprenait alors de mettre en chantier le feuilleton Twin
Peaks qui allait marquer de son empreinte l'histoire
de la télévision. A l'origine, Mulholland
Drive aurait été imaginé comme
un possible spin-off de Twin Peaks, c'est-à-dire
une série télévisée parallèle,
qui développerait une histoire entièrement
nouvelle en conservant quelques personnages et une atmosphère
de base. Mais cette option n'avait abouti à rien,
et demeurait donc telle quelle dans les limbes lynchiennes :
un feuilleton télévisé qui porterait
le nom magique d'une célèbre avenue de la
Cité des Anges.
Puisque Mulholland Drive était tout d'abord
destiné à appartenir à la même
famille que la première création télévisuelle
de David, dissipons d'ores et déjà une méprise
fréquente dans la dénomination ou la classification
de Twin Peaks, qui est un feuilleton et non pas une
série télévisée, bien que ce
dernier terme serve à tort aujourd'hui pour désigner
indifféremment les deux genres pourtant fort distincts
l'un de l'autre (sans compter que le terme feuilleton
paraît inexplicablement désuet ou même
ringard dans le vocabulaire contemporain). Une série
prend pour postulat un certain nombre de personnages évoluant
dans un environnement et un contexte fixes, dont l'équilibre
est invariablement mis en péril au début d'un
épisode avant de se rétablir à la fin
de ce dernier. De plus, l'ordre de ses épisodes n'a
somme toute que peu d'importance et n'intervient d'ailleurs
que très rarement dans l'intrigue imaginée
par des bataillons de scénaristes : leur diffusion
pourrait quasiment se faire au hasard sans incidence majeure,
si l'on se réfère par exemple à l'un
des modèles du genre, Mission : Impossible.
Cette absence de chronologie n'est d'ailleurs pas sans avoir
un effet involontairement surréaliste et comique,
puisque ce type de héros semble vivre indéfiniment
dans un espace-temps immuable, comme s'il revivait sans
cesse le même continuum temporel sans évoluer
d'un iota, sans faire référence à son
passé ni en tirer d'enseignements particuliers, tel
un bloc infissile donné une fois pour toutes (ce
qu'est en fait littéralement la fameuse bible
que confectionne le créateur de toute série
et que chaque scénariste doit compulser fébrilement
pour ne pas s'éloigner de la ligne de conduite définie
au préalable dans les moindres détails.)