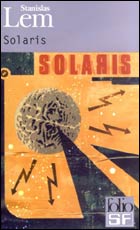 |
|
|
|
Tarkovski a su aussi trouver de
nouvelles formes visuelles pour l’adaptation de l’œuvre
littéraire, avec, par exemple, la bande vidéo
du compagnon décédé de Kris :
Gibarian. On le voit en images expliquer qu’il se passe
des choses étranges dans la station. Chez Lem, ce
message laissé à Kris était enregistré
sur un magnétophone. En même temps, cela nous
permet d’apercevoir le visiteur de Gibarian, qui est une
fillette. Le choix de montrer ces visiteurs constitue une
des grandes différences avec le roman.
Lem choisit de ne pas évoquer les visiteurs des deux
autres scientifiques présents avec Kris dans la station.
Chez Tarkovski, on les aperçoit pourtant, l’espace
de quelques secondes : une oreille chez Snaut et un nain
chez Sartorius, ce qui contribue à renforcer l’aspect
surnaturel de ces apparitions.
Le plus important, quand on compare les deux œuvres, reste
indéniablement la fin de l’histoire, liée
à l’hypothèse de l’existence ou non d’un Dieu
gouvernant la planète Solaris. Le personnage de Lem
reste sur la station pour continuer ses expériences
afin de communiquer, un jour, avec Solaris et espérer
secrètement revoir la femme aimée. Le roman
se clôt donc sur l’attente et l’espoir.
La fin de Tarkovski est beaucoup plus pessimiste. Dans le
tout dernier plan du film, on voit la maison d’enfance de
Kris, mais la caméra s’élève et l’on
découvre que cette maison se trouve sur une île.
La maison a été reconstruite par L’Océan
à partir des souvenirs de Kris. Ce dernier se trouve
donc prisonnier de ses rêves, de son passé,
de lui-même dans l’environnement reconstitué
par Solaris.
(On peut même aller plus loin en avançant l’hypothèse
que ce n’est peut-être pas Kris qui se trouve sur
l’île mais son clone).
| |
 |
|
|
Quant à l’idée que
Solaris soit une sorte de Dieu (ou non), le roman ne tranche
pas. Il expose les deux hypothèses qui ouvrent sur
un champ de possibilités presque infini, laissant
ainsi au lecteur le soin d’imaginer sa propre fin. Dans
la première hypothèse, le Dieu Océan
serait, comme le pensaient autrefois les spéculateurs
de la Kabbale juive dans leur doctrine du Tsintsoum (voir
notes) un Dieu imparfait, à la recherche de quelque
chose ou de quelqu’un qui comble son manque. Kelvin le résume
ainsi : " Un Dieu imparfait, limité
dans son omniscience et dans sa toute puissance, faillible,
incapable de prévoir les conséquences de ses
actes, créant des phénomènes qui engendrent
l’horreur ".
Mais à la suite de ce postulat, Lem à travers
le personnage de Kris, développe une seconde hypothèse
(impliquant l’impossibilité de communiquer avec L’Océan) :
Solaris n’est peut être " qu’un enfant
au comportement quelque peu extravagant, qui enverrait aux
hommes des simulacres de vie pour tenter de les comprendre. "
Mais, face à l’échec de l’établissement
d’une quelconque communication, il faut se résigner
(comme Kris) à abandonner l’hypothèse d’un
Solaris-Dieu. Car Solaris n’a pas besoin, contrairement
au Dieu imparfait de la Kabbale, du concours des hommes
puisqu’il n’a pas, comme le croient les scientifiques qui
l’étudient, de conscience supérieure.
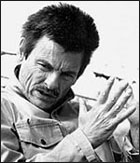 |
|
|
|
Tarkovski suit plutôt la première
hypothèse et aborde la représentation de la
présence divine sous l’angle de la nature des rapports
entre les différents personnages. Pour Tarkovski,
grand mystique orthodoxe, la réponse devrait passer
par Dieu. Mais ce n’est pas le cas : le cinéaste
n’envisage pas la planète Solaris sous la forme d’un
Dieu, puisque si la planète Solaris était
un Dieu, une notion d’espoir serait présente à
la fin du récit. Or, dans ce Solaris version cinéma,
l’espoir est étouffé, la boucle se referme
et Kris reste prisonnier. Il semble que Tarkovski ait voulu
plutôt donner l’idée d’une entité sans
conscience, qui opère un mécanisme de recréation
offrande que le cinéaste conçoit plus automatisé
que pensé par L’Océan.