| |
 |
|
|
En 1976, Barbara Kopple achève la réalisation
de Harlan County documentaire dont le tournage a duré
plusieurs années, servi par un travail de compilation d’archives
et une relation très proche aux mineurs et à leur famille
dont elle suit les luttes difficiles, longues et parfois sanglantes.
La même année Union Maids évoque l’organisation des
luttes ouvrières dans différents lieux.
En 1977, With Babies and Banners de Lorraine Gray,
Lyn Goldfarb et Anne Bohle représente avec force le point
de vue des femmes pendant une grève automobile dans une usine
automobile en 1930.
En 1980, The Life and Times of Rosie the Riveter de
Connie Field démontre que l’utilisation d’archives en un montage
ingénieux peut constituer une démonstration brillante et ironique
du film de propagande, ici l’exemple des discours appelant
les femmes à rejoindre en masse les usines pendant la guerre
pour y remplacer les hommes au front puis à retourner à leur
cuisine quand on n’a plus besoin de leur bras. Connie Field
en profitera pour évoquer les femmes noires, sempiternelles
oubliées de l’histoire officielle, qui ont contribué par leur
travail au maintien de l économie.
 |
|
|
|
Tous ces films utilisent des images d’archives
et des entretiens réalisés lors du tournage, offrant par ce
croisement inédit d’images et de sons une nouvelle perspective
propice à de nouvelles interprétations et à un rétablissement
de l’Histoire des femmes.
Lorsqu’en 1975, Chantal Akerman réalise Jeanne Dielmann,
23 quai du commerce, 1080 Bruxelles , le fameux débat
fiction-documentaire perd son sens. Akerman travaille dans
ce film toutes les questions du corps, du sexe, de l’argent,
du stéréotype sexuel, de l’hétérosexualité, de la famille
et du travail ménager avec une acuité extraordinaire.
Des années 60 a nos jours, Agnès Varda, Ulrike Ottinger, Chantal
Akerman, Mira Nair, Solveig Anspach représentent cette perspective
de cinéma. Elles naviguent d’ailleurs toutes de la fiction
au documentaire.
Lourdes Portillo, Trin T.Minh-ha, Yvonne Rainer, Barbara Hammer,
Vivian Ostrovski, Naomi Kawase vont chercher du côté de l’expérimentation
une vision décalée, et pertinente des enjeux de la représentation
de l’histoire, histoire intime ou histoire politique.
| |
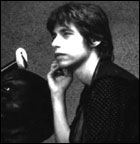 |
|
|
Nurith Aviv, Heddy Honingman, Carmen Guarini,
Kim longinotto, Simone Bitton affirment au cours de leurs
films une implication politique dans une forme plus classique
de cinéma mais tout aussi efficace.
Des portraits, des autoportraits, des parcours intimes questionnent
l’histoire, la famille, l’identité, la perte, l’exil prenant
valeur universelle de remise en cause de l’appartenance visible,
brisant des silences politiques. Diario de Marilu Mallet
(1983), Surname Viet Name Nam de Trinh T. Minh-ha (1989),
Nos traces silencieuses puis Séparées de Sophie
Bredier et Myriam Aziza (2000-2001).
|