| |
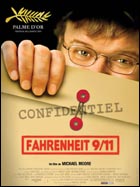 |
|
|
Le même jour, dans la même ville (au Roxane),
j’ai aussi pu voir en v.o. Fahrenheit 9/11, sorti
la semaine précédente. Fait très rare pour un film bénéficiant
d’autant de salles (69 au total le 14 juillet 2004),
une très grande majorité de cinémas de banlieue ont choisi
la v.o. (36, contre 5 pour la v.f.), tous les cinémas parisiens
ayant pour leur part préféré la v.o. (28, aucun pour la v.f.),
sans que son succès s’en ressente (salle comble et applaudissements
pour la projection à laquelle j’ai assisté). Privilège d’un
film palmé d’or ? Exception due au genre documentaire ?
A contrario, l’autre film consacré au Monde selon
Bush, auquel d’aucuns ont voulu l’opposer à son détriment,
est passé en français (deux salles à Paris, aucune en banlieue
le 14 juillet 2004). Rien de plus normal pour un film français ?
Sauf que le film de William Karel est aussi composé, et presque
exclusivement dans son cas, d’un montage d’entretiens avec
des personnalités américaines, dont la voix est recouverte
pour un "doubleur" français (procédé dit de la voice
over). Cependant, cela n’est pas un inconvénient majeur,
Le Monde selon Bush n’apportant quasiment rien au point
de vue cinématographique aux éléments d’information donnés
par les personnes interrogées (6), au contraire du film de
Michael Moore, où le traitement du son importe (notamment
par la mise en valeur des intonations, rodomontades, hésitations
et autres bafouillages du Président Bush). Car, comme le conclut
Serge July dans l’éditorial qu’il a choisi d’écrire lui-même
pour la section « Événement » de Libération
consacrée à Fahrenheit 9/11, la "critique",
très favorable, étant quant à elle signée Patrick Sabatier,
directeur adjoint de la rédaction, et non par un journaliste
du cahier Cinéma, véritable camouflet infligé au service Culture
de Libé (qui s’était mobilisé en mai pour dénoncer
une palme politique décerné à cet excellent documentariste,
de moins bon goût il est vrai que Marcel Ophuls, dont il reprend
maints procédés), « Michael Moore est aussi un cinéaste ».
Cela rend d'autant plus précieux le choix de la v.o.,
très largement effectué par les distributeurs
français, probablement en accord avec le cinéaste,
ce qui va à l'encontre de l'image d'un cynique prêt
à assurer son succès à tout prix, image
qu'essaie tant bien que mal de donner ses détracteurs.
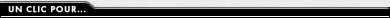 |
|

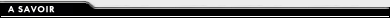 |
|
(1) AFF : ex-Service des Archives du Film.
(2) « Pratiquement », car il arrive,
assez rarement, que des projections soient proposées
au Centre socioculturel. Depuis trois ans, la
municipalité organise, avec la collaboration des
AFF, un festival annuel de cinéma, qui présente
un intérêt relatif.
(3) À proprement parler, l’expression v.f. doit
être réservée aux versions françaises des films
réalisés en versions multiples, c’est-à-dire en
plusieurs langues, ce qui a surtout été fait au
début des années trente, les plus célèbres étant
le fruit de co-productions franco-allemandes.
Sur les versions multiples réalisées à Hollywood
entre 1929 et 1935, à propos desquelles Claude
Autant-Lara a écrit des souvenirs vengeurs (Hollywood
Cake-Walk (1930-1932), Éditions Henri Veyrier,
1985, 408 p.), voir le livre que Martin Barnier
a publié en juin 2004 chez L’Harmattan (Des
films français made in Hollywood, 274 p.).
(4) « Sur le doublage de Wild Wild West »,
voir
le reportage publié par François Justamand dans
la rubrique « Hors Champs » et dans
la « Gazette du doublage » d’Objectif-cinéma.
(5) Il serait à cet égard intéressant de connaître
l’incidence des unes de ces deux publications
sur leurs ventes. Et, par voie de conséquence,
comment s’effectuent les choix de l’une et de
l’autre, et plus vraisemblablement les négociations
pour l’obtention du droit de reproduire telle
ou telle affiche, car il est peu plausible que
L’Officiel des spectacles ait choisi Mille
millièmes plutôt que Men in Black II
sans autre considération que l’intérêt respectif
des deux films, en lui-même ou comme stimulant
de vente de la publication. A contrario, le 14
juillet 2004, les deux concurrents ont chacun
reproduit en couverture une affiche de Spider-Man 2,
l’un des douze films sortis ce jour là, mais pas
la même. Pariscope a d’ailleurs choisi
de publier trois éditions différentes, avec trois
affiches différentes du même film.La semaine suivante,
Pariscope arborait une nouvelle affiche de Spider-Man
2 en couverture, avec en bandeau une citation
de Première tout à fait adaptée
: " Spider-Man 2 : 2 fois mieux ! "
(6) Il est à cet égard éloquent
que l'une des très rares scènes
assez puissantes cinématographiquement
parlant, en tout cas émouvantes, soit l'une
des seules sous-titrées : celle où
un vieux sénateur harangue ses pairs pour
dénoncer la politique guerrière
de G.W. Bush, en gesticulant et en élevant
la voix autant que sa santé vacillante
le lui permet.
|
|
|