| |
 |
|
|
On s'est beaucoup questionné
pour savoir de quel ordre elle devait être… Moi,
je voulais de la guitare, par amour personnel de la guitare
électrique, et en même temps il était
hors de question que ce soit un film rock n'roll, donc il
fallait trouver comment extirper de la guitare des sons,
des dissonances, des harmonies qui ne soient pas évidentes.
Quelque part, la musique devait nous renvoyer au sentiment
intérieur de l'homme. On se racontait des histoires
comme ça avec Jean-François Pauvros. En même
temps, elle devait traduire cette espèce d'alchimie
mystérieuse entre les espaces et les zones secrètes
du désir entre cet homme et toutes ces femmes. Il
y a quelque chose d'expérimental dans ce travail.
Un film m'a beaucoup marqué sur le plan musical,
même s'il ne nous a pas du tout animés sur
le plan de l'inspiration, un film où l'univers musical
était un peu psychotique. En fait, je pense à
deux films : le travail d'Howard Shore sur " Crash
", et le travail de Neil Young sur " Dead Man
". Deux musiques totalement différentes. Chez
Jarmusch, c'est une série d'accords aux limites du
country-rock, étirés, qui arrivent comme une
litanie répétitive et qu'on traitait sur des
longueurs différentes, quelques fois sur des rythmes
légèrement différents, et au bout d'un
moment ça participe d'un rythme et d'une atmosphère
un peu psychotique.
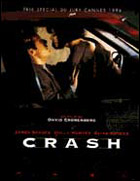 |
|
|
|
Sur " Crash ", la manière
dont travaille Howard Shore est aussi de cet ordre-là
: arriver à… Ce n'est guère étonnant
qu'il travaille régulièrement avec Cronenberg,
un des grands décortiqueurs de pulsions, il éventre
les gens pour savoir de quoi l'homme neuronal est fabriqué,
de toutes les peurs qui entourent le corps humain et l'imaginaire
autour du corps humain. Ils ont mis au point un travail
de l'ordre de l'interpénétration de la musique
et de l'image qui me convainc tout à fait.
Vous savez, j'ai commencé dans le cinéma expérimental,
un cinéma non narratif où tout le but était
d'essayer de trouver des logiques visuelles, des rapports
purement plastiques et intrinsèques à l'image
pour développer des durées. C'est vrai que,
sans doute, ça m'a renvoyé aux origines de
mon cinéma qui était du super-8, image par
image, que je retravaillais rythmiquement. J'ai fait comme
ça un film expérimental à la fin du
phénomène punk, au début des années
80, où j'allais de concerts en concerts et j'en ramenais
des vibrations lumineuses dans les rapports des musiciens
à l'espace scénique, c'est un film que j'ai
retravaillé ensuite photogramme par photogramme,
en travaillant sur des logiques sonores qui n'étaient
en aucun des musiques synchrones mais plutôt des analogies
entre l'espace citadin et la pulsion de révolte intrinsèque
à ce type de musique. J'ai une vraie croyance dans
le fait que le cinéma est plus proche de la musique
en tant que matière artistique. Beaucoup plus proche
de la musique que du roman, du théâtre. Il
y a quelque chose d'intrinsèque au cinéma
qui est de l'ordre purement rythmique, et mystérieux
comme la musique. La musique est quelque chose qui n'est
pas foncièrement terrien, qui nous emmène
dans des vibrations qui nous dépassent et nous surprennent
parce qu'on est tout à coup frissonnant, transpirant.
La musique va jusqu'à la transe religieuse. On trouve
ça dans l'électro aujourd'hui, dans le côté
extrêmement répétitif, dans le martèlement,
dans la recherche d'adéquation avec le corps. Il
y a quand même une jouissance incroyable, à
un moment donné on a l'impression d'être dans
le fusionnel, d'échapper à la condition de
terrien, d'être projetés dans les espaces quasiment
hallucinés, comme la drogue, sauf qu'on n'a pas besoin
de drogue. J'ai envie de continuer à expérimenter
ces rapports de la musique et de l'image, et mon prochain
film va vraiment traiter de ça. Il est question des
mutations d'un garçon de 17 ans par la passion musicale.