Mathieu Amalric,
bonjour. Si Objectif Cinéma se trouve chez vous aujourd’hui,
c’est parce que nous avons eu la chance d’assister à
l’avant-première de votre film Le Stade de Wimbledon
(Sortie en salles : 13 février 2002), au Forum
des images à Paris en novembre dernier, et que ce fut
un moment rare. Au terme de la projection, vous avez pris
la parole et, en quelques mots assez brefs, vous avez évoqué
votre œuvre d’adaptation du roman éponyme de Daniele
Del Giudice (Rivages, 1985). " J’ai tenu à
rester extrêmement fidèle au texte du roman ",
avez-vous déclaré, comme si vous n’aviez effectué
qu’un travail de transcription d’une écriture à
une autre, de transposition d’un langage littéraire
à un langage cinématographique.
A vrai dire, je n’y ai pas
cru une seule seconde, et c’est ce qui m’a donné envie
de vous proposer cet entretien. Je n’y ai pas cru, parce que
le mode de narration déployé dans votre film
m’a paru singulier, proprement cinématographique et
ce, notamment en raison d’une histoire de temps.
| |
 |
|
|
Votre film se déroule
sans heurts, en toute fluidité, dans une continuité
de tous les instants (au sens mathématique du terme :
on a l’impression qu’il n’y a pas d’inflexion dans la narration).
Mais cette continuité, pour être narrative, n’est
en rien chronologique : le film est découpé
en quatre grandes séquences espacées de plusieurs
mois, relatant chacune une journée à Trieste
lors d’une saison particulière. Il s’agit plutôt
d’une continuité dans la quête de la narratrice,
qui est aussi le personnage principal, et qui recherche dans
tout Trieste les traces d’un écrivain qui n’aurait
jamais écrit. Une continuité étrange,
qui se traduit plutôt à travers des interrogations
réflexives et itératives, qui se conjuguent
succesivement au passé et au présent.
Notamment, il y a cette
scène de l'été où la narratrice
(Jeanne Balibar) dérive au fil de l’eau, allongée
sur sa planche à voile, alors que sa voix off
commente l’état de ses recherches sur cet écrivain
qui n’a jamais écrit. Puis une autre scène se
déroule, filée à la précédente,
avec d’autres recherches dans Trieste et qui amènent,
en quelques secondes, Jeanne Balibar à se retrouver
en maillot de bain sur une planche à voile, et à
dériver à nouveau au fil de l’eau. La bobine
a un peu tourné, un peu de temps de film s’est écoulé
mais à son terme, la narratrice se retrouve au moment
chronologique initial du récit. Alors même que
le récit lui-même ne s’est pas arrêté….
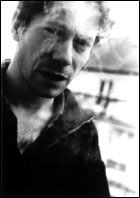 |
|
|
|
Je l’avoue, j’ai cru qu’il
était impossible d’obtenir cet effet, ce tour du magie
en littérature (mais je lis peu de romans, il est vrai…).
J’ai pensé que seule l’écriture cinématographique,
audiovisuelle et, peut-être demain, multimédia,
permettait d’obtenir ce type d’œuvres continues dans le récit
et discontinues dans le temps, grâce à des procédés
comme la voix off ou le montage. Il m’a semblé
impossible que vous ayez pu à la fois " être
fidèle au texte du roman " et faire ce
film-là. Et j’ai donc eu envie de vous demander :
honnêtement, Mathieu Amalric, n’avez-vous pas mis en
place un mode de récit que le cinéma permet,
et que le seul texte ne permet pas ?
Mais avant de vous interroger
à ce sujet, il m’a bien sûr fallu lire le roman ;
ce que j’ai fait. Et, d’emblée, j’ai réalisé
que je m’étais trompé, qu’on y retrouvait exactement
le même mode narratif que dans votre film. Quoique…
Exactement, c’est beaucoup dire. Disons simplement que le
montage d’un plan à un autre est remplacé, dans
le roman de Daniele del Giudice, par un procédé
plus invisible : le simple passage à la ligne,
d’un paragraphe à un autre. Et ce qui m’a frappé,
dans ce livre, c’est tout autant cette impression de fluidité ;
tous ces passages, constants et imperceptibles, d’un paragraphe
où le narrateur décrit ses états d’âme
longuement, au présent – c’est la lenteur, le
rythme de la pensée -, à un autre paragraphe
où il raconte ses actions, rapidement, au passé.
|