 |
|
|
|
Objectif
Cinéma : Travaillez-vous
toujours avec la même équipe ?
Jean-Pierre Lelong : Je travaille toujours avec le
même assistant, mais par contre, je change pratiquement
à chaque film d’ingénieur du son. Souvent, les
ingénieurs du son sont attachés à des
studios, et comme je change souvent d’endroits pour des raisons
de production, je me lie à l’ingénieur du son
qui est attaché au studio. Il y a aussi beaucoup d’intermittents
en la matière, des gens qui sont parachutés
sur les films pour enregistrer les post-synchronisations et
les bruitages, ou qui vont avoir le volume de travail de finition
de son, c’est-à-dire post-synchro, bruitage et mixage.
Quelquefois, c’est la même personne qui fait tous les
travaux, parce que les réalisateurs préfèrent
souvent n’avoir qu’un seul interlocuteur sur leur film. Il
y a la personne qui s’occupe du son direct, et celle qui s’occupe
de la post-production sonore ; ça se passe comme
ça.
Quant à mon assistant, c’est la même personne
depuis très longtemps, car il connaît mes habitudes :
j’ai 400 kilos de matériel disséminé
dans des valises différentes, tout est un peu mélangé,
et il connaît tout cela par cœur ; ce qui permet
de ne pas me préoccuper de ça, et de me concentrer
sur l’image.
Objectif Cinéma : Vous
collaborez avec le mixeur ?
Jean-Pierre Lelong : Par courtoisie,
je vais aux séances de mixage, mais je n’interviens
pas. C’est le mixeur qui fait son travail, en collaboration
avec le réalisateur.
Objectif Cinéma : Est-ce
un métier qui s’apprend de père en fils ?
Jean-Pierre Lelong : Oui, de père en fils, de
frère à frère, frère à
sœur…Il y a deux familles de bruiteurs, les Lévy et
les Naudin. Pour les Lévy, le père, Jacques,
qui est un personnage très connu dans le cinéma,
avait une société de post-synchronisation ;
deux de ses fils sont bruiteurs, et le troisième est
perchman. Je connais les Naudin, d’abord le père depuis
25 ans, puis j’ai connu les fils ; mais ils ont tous
commencé plus tard que moi.
Mais c’est très fermé comme milieu ! C’est
un métier qui se transmet, bien sûr, car il ne
s’apprend pas, il faut découvrir ça en étant
sur le tas. Tout à l’heure (à la rencontre publique,
ndlr), une jeune fille me demandait s’il y avait une école,
mais il n’y en a pas. Je lui ai proposé de passer au
studio, pour lui faire faire quelques essais, et je verrais
tout de suite si elle a la fibre ou pas.
Le bruiteur est le travailleur de l’ombre, au vrai sens du
mot ; on est dans le noir, et toujours en vase clos.
C’est un métier méconnu, surtout la manière
dont il se pratique. J’ai fait quelques démonstrations
pendant les César, en direct, trois années de
suite. Et puis je me suis aperçu que c’était
un peu comme déflorer la magie du métier, donc
j’ai arrêté, je ne voulais plus en faire. C’est
vrai qu’on est très sollicité, pour faire des
démonstrations dans les festivals. Mais je n’aime pas
trop montrer comment ça marche, parce qu’après
les personnes qui voient ça ne voient plus les films
de la même façon. Lorsqu’ils voient des gens
qui marchent dans la neige, ils se disent " ah oui mais… ".
Il n’y a plus de poésie, cela devient technique.
| |
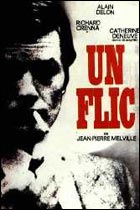 |
|
|
Objectif
Cinéma : Vous prenez
donc des apprentis ?
Jean-Pierre Lelong : Non, on
ne le fait pas. Tout d’abord parce que cela ne plaît
pas au réalisateur que l’on voit leur film avant qu’il
ne soit tout à fait terminé. Or, moi je vois
le film à l’état brut. Mais je demande quelquefois
au réalisateur, par courtoisie - et il ne me le refuse
jamais d’ailleurs - d’amener quelqu’un pour une journée
ou une demi-journée, pour qu’il regarde comment ça
marche. Quelquefois, viennent des étudiants de la Fémis,
de Louis Lumière, pour regarder comment ça fonctionne.
Mais j’ai en fait un assistant depuis si longtemps, que je
ne pourrais pas prendre quelqu’un d’autre.
|