|
Objectif
Cinéma : La
figure de la déambulation est très importante
dans ces films. Peut-on la lier avec la déambulation
situationniste ?
Jean Rollin :
Oui, tout à fait, les dérives situationnistes
ressemblaient un peu à ça. Sauf qu’on savait
où l’on allait, alors que le principe de la dérive,
c’est d’aller au hasard, mais bon… C’était un peu ça.
Objectif Cinéma :
Dans La Vampire Nue,
vous mettez en place des éléments qui feront
écho par la suite dans vos autres films.
Jean Rollin :
Ce n’était pas vraiment délibéré,
mais j’aimais bien, à ce moment-là, partir d’un
élément d'un film précédent, que
je n’avais pas pu approfondir pour une raison ou pour une
autre. Dans un de mes films (4), il y avait un personnage
de clown qui ne demandait qu’à être développé.
Je l’ai retravaillé ensuite dans Requiem. Et
comme je n’en avais pas fini avec lui, je l'ai replacé
dans les Démoniaques.
Objectif Cinéma :
Qui est Jacques Robiolles ?
Son personnage de Maître voire de gourou dans La
Vampire Nue et Le Frisson du Vampire est particulièrement
fascinant.
Jean Rollin :
Robiolles est un personnage très intéressant.
Il est réalisateur de films d’avant-garde extrêmement
intéressants (5), il était très lié
avec Langlois, Mary Meerson, et la Cinémathèque.
Quand il était vraiment fauché, on lui faisait
vendre les tickets à la Cinémathèque.
Si on voulait le trouver, il fallait venir le soir à
Chaillot, rue d’Ulm.
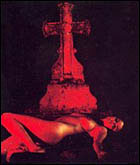 |
|
|
|
Objectif Cinéma :
L'idée de communauté vampirique comme communauté
idéale parcourt ces films. Cela provient-il également
de ce vivier intellectuel ?
Jean Rollin :
Oui, il faut qu’il y ait un personnage autour duquel se manifeste,
si l’on peut dire, une sorte de communauté, un " gourou "
est nécessaire. Pour nous, c’était Losfeld avant
tout, et un petit peu Boullet, car il avait aussi une aura
importante ; il était le seul à avoir vu
quantité de films mythiques, il avait travaillé
avec Kenneth Anger, avec Cocteau…C’était un personnage.
Quand il racontait des souvenirs, on se rassemblait près
des caisses, autour de lui. Et puis il y avait Langlois, bien
entendu, qui était pour nous "le" personnage-cinéma,
qu’on écoutait respectueusement aussi. Pour nous qui
étions très jeunes, encore étudiants,
tous ces gens-là étaient des phares. Et comme
en plus, ils étaient tous très conviviaux, affables
et disponibles… On faisait notre apprentissage chez eux :
j’ai appris la littérature chez Losfeld, et j’ai appris
le cinéma chez Langlois.
Objectif Cinéma :
Pouvez-vous nous parler des
images quasi-surréalistes, des " images-collages "
qui parsèment vos films et en particuliers la
tétralogie ?
Jean Rollin :
J'avais l'idée de faire quelque chose d'équivalent
aux serials américains, qu’on allait voir étant
gosse dans les " Cinéacs " ;
c’étaient des films de 20-25 minutes, et souvent des
serials (6). Il y avait trois ou quatre épisodes différents
qui passaient au cours d’une même séance. À
l'époque, j’étais au lycée Buffon, pas
très loin de la gare Montparnasse, et toutes les semaines,
nous allions en voir.
| |
 |
|
|
Plus
tard, j’ai retrouvé l’esprit des serials dans les collages,
particulièrement ceux de Max Ernst, La Femme 100
Têtes, Une Semaine de Bonté, etc., et plus
tard aussi ceux de Prévert.
Le collage était un moyen d’arriver à l’esprit
très particulier des films à épisodes,
sans que cela coûte une fortune. Cela me permettait
de fabriquer des images comme des collages : c’est-à-dire
des images qui pouvaient être intéressantes en
elles-mêmes, sorties du contexte du film. Plusieurs
séquences de films sont donc faites pour introduire
une image. Par exemple, dans Requiem Pour un Vampire,
j’avais l’idée d’une femme qui jouait du piano à
queue dans un cimetière. J’ai écrit une partie
du scénario pour arriver à placer cette image…
Et je l’ai placé (rires). Il y a quantité
de choses de cet ordre-là. On travaillait certains
plans particuliers du film, qui devaient constituer l’apogée,
le point culminant, et tout devait y conduire ; parce
qu’il fallait quand même justifier un petit peu la présence
de ces images.
|