 |
|
|
|
Objectif
Cinéma : Les paysages
et les visages sont à la base du cinéma… dans
la mesure où filmer un paysage ou un visage en plan
fixe pendant un certain temps peut s'avérer passionnant...
Alain Raoust : Oui. Il
existe un très beau film de Jonas Mekas de dix minutes
sur un lever de brouillard dans la campagne. On ne voit rien
au début, tout est blanc, puis petit à petit
on découvre des vallons, des vergers, un clocher au
loin, et la simple disparition du brouillard donne à
regarder successivement plusieurs tableaux. Michael Cimino
est aussi souvent parti radicalement du paysage, que ce soit
dans Sunchaser ou dans ses autres films. Là,
le paysage est là, non pas comme décor, mais
comme partie prenante de la narration, comme acteur, comme
personnage.
Objectif Cinéma :
Pour La cage, est-ce que les
décors et les paysages étaient présents
de manière précise dès l'écriture
?
Alain Raoust : Oui, très
vite. Il s'agissait de filmer dans un paysage urbain, un peu
à la campagne, et en ce qui concernait les Alpes, je
voulais tourner dans une station hors-saison pour retrouver
une dimension désertique, et essayer de retrouver ce
qui réduit le western à l'allée centrale,
la prison et le saloon. Retrouver cela avec pratiquement personne,
et une atmosphère un peu pesante. Je n'aurais pas pu
tourner le même film au mois de janvier, c'est évident
! Cela dit, un de mes rêves est de tourner un film sous
la neige. J'y suis très sensible. Mais ce qui m'attire
surtout avec la neige, c'est certainement le blanc et le paysage,
mais surtout le son, cette espèce de cloche de sons
sourds. Les idées de films ne naissent pas forcément
de narration mais de plaisirs sonores et d'images, même
s'il faut absolument se méfier des images quand on
fait du cinéma. L'ennemi du cinéma, c'est l'image.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître. L'image qui
n'a pas de sens, qui ne sert à rien, l'image esthétisante…Il
ne faut pas partir de l'image, c'est assez paradoxal. Il faut
partir du réel peut-être : d'un paysage, mais
pas de l'image du paysage.
| |
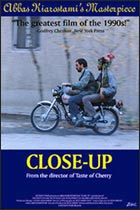 |
|
|
Objectif
Cinéma : La
vie sauve et La cage
sont deux films qui ont la puissance du cinéma muet…
Par conséquent il y a l'idée de faire tout de
même confiance à l'image…
Alain Raoust : Oui, voilà.
D’ailleurs Antonioni ou Bresson ont fait confiance au visuel,
à l'image. Mais faire confiance à l'image ne
veut pas dire penser en images. Débuter un scénario
et penser en images, c'est selon moi prendre une mauvaise
voie. C'est ce que je me dis à longueur de journée.
C'est au moment du tournage qu'il faut faire confiance à
l'image.
Objectif Cinéma :
C'est une voie pas forcément
très explorée dans le cinéma français…
Alain Raoust : Je pense
que Philippe Ramos, Yves Caumon, Jean-Paul Civeyrac, Orso
Miret, etc, font confiance au visuel mais ne pensent pas forcément
en terme d'images. On pourrait opposer à ça
les Besson et autres Kounen, qui pensent en images. D'où
n'importe quoi à un moment donné. Je pense plus
le réel, j'essaye de plus penser l'acteur, le son,
les absences, les creux, le montage… J'ai une manière
de travailler et de vivre, de percevoir le réel, d'y
être attaché. Quand je pense à ça,
je pense immédiatement à la scène où
une petit bouteille roule sur le sol dans Close-up
de Kiarostami. Une séquence incroyable où il
ne se passe rien et où un type regarde simplement un
flacon rouler le long d'une rue jusqu'à ce qu'il s'arrête
au bord d'un trottoir, avec le son creux et métallique
de ce genre de bouteille. C'est un truc du réel qu'on
peut observer d'une terrasse de café, on le note, on
cherche ensuite à le construire et à le faire
exister dans un film.
|