| |
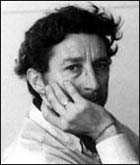 |
|
|
Objectif Cinéma :
Vous êtes le décorateur de
Robert Guédiguian depuis son premier film...
Michel Vandestien :
Dans la compagnie de La salamandre il y avait un jeune comédien,
Pierre Ascaride. Un soir, c’était en 76, sa sœur Ariane et
son mari assistent à une représentation. Il vient me voir
ensuite et me dit : « je vais bientôt faire du cinéma,
tu seras mon décorateur à vie ». C’était Robert Guédiguian,
et il m’a effectivement appelé deux ans plus tard.
Objectif Cinéma :
Dans son cinéma, l’intervention
du décorateur n’est pas toujours perceptible au spectateur
lambda.
Michel Vandestien :
Guédiguian fait des films « naturalistes », des
contes. Le travail consiste à ordonner la réalité. Je n’aime
pas le mot réalisme dans le cinéma. A partir du moment où
il y a une caméra, il n’y a plus de réel. C’est une invention,
il y a les focales, ou du noir et blanc, la musique…
En tant que décorateur - le terme italien scénographe est
plus juste - je me considère comme assistant du metteur en
scène. Je suis le film de A à Z. Les repérages sont très importants.
Je trouve aberrant de les confier à des régisseurs ou à des
assistants. Guédiguian est un des rares à être d’accord sur
ce point. J’ai fait aussi des repérages avec Carax, pour trouver
des similitudes, une continuité entre les extérieurs et les
décors en studio. Avec Guédiguian, il m’est même arrivé de
participer au casting du chef opérateur, en cherchant une
affinité avec le projet.
 |
|
|
|
Objectif Cinéma :
Quelle est l’exigence de Robert
Guédiguian par rapport au décor ?
Michel Vandestien :
Il tourne toujours à Marseille. Ou alors on triche un peu,
on dit que c’est Marseille alors que c’est Martigues. C’est
comme sa plume d’écrivain, c’est sa langue et il est légitime
que cette ville soit toujours son décor. Et c’est toujours
en décors dits naturels, on a recours au studio seulement
quand on ne trouve pas ce qu’on veut.
A Marseille, il recherche les endroits, les lieux justes.
Ce qu’on va en extirper, rajouter ou enlever, pour donner
du sens, pour situer les personnages dans leur milieu. Guédiguian
tient beaucoup à ce coté révélateur du décor. Il doit toujours
être socialement en amont des personnages. Il faut que les
personnages aient un passé au début du film. C’est aussi pour
ça qu’il prend des acteurs issus comme lui de milieu ouvrier.
C’est le cas de Gérard Meylan, d’Ariane, de Jean-Pierre Darroussin.
Objectif Cinéma :
Aujourd’hui, ses acteurs ont
tous la quarantaine, et déjà une vie, un vécu derrière eux...
Michel Vandestien :
Parce qu’il est fidèle à ses amis, tout simplement. Il a commencé
avec eux il y a 25 ans, alors qu’ils faisaient le conservatoire.
Mais Robert me pousse toujours à embaucher des gens jeunes.
C’est ce que je recherche aussi, comme pour assurer la relève.
D’ailleurs, il me dit sans arrêt que je suis trop vieux pour
faire ce métier (rires).
| |
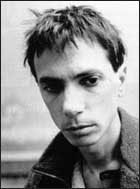 |
|
|
Objectif Cinéma :
En schématisant, il y a deux
écoles dans votre filmographie : des films naturalistes
et d’autres plus stylisés.
Michel Vandestien :
Ils racontent toujours des histoires qui me plaisent. Des
histoires où je me reconnais, des personnages qui montrent
une vérité, une part de notre vie. Cela passe par une sensibilité
et aussi une certaine vision politique. C’est donc une question
d’affinités, pas d’école esthétique. Ca peut être très vaste
dans le genre, mais on raconte toujours les mêmes histoires.
Objectif Cinéma :
Mauvais sang est un film très
stylisé, en particulier dans le traitement des couleurs. D’où
vient ce parti pris ?
Michel Vandestien :
Carax est quelqu’un qui n’arrive pas à visualiser ce qu’il
écrit. Je pense que visuellement il n’avait pas son film dans
la tête. Mais il tenait à tourner en studio pour tout inventer.
Donc ça passait par le décor, par la photographie. Il y a
eu une très longue préparation, et j’ai fait de nombreuses
maquettes en volume.
Carax devait avoir dans les 24 ans à l’époque, il voulait
un univers très stylisé et proche de la bande dessinée. Il
me montrait les vieilles éditions de Tintin, les à-plats de
couleurs sur papier pelure. Mon rapport à la peinture est
très important, je lui parlais de Poliakoff, Matisse, ce qu’est
un bleu, un rouge, un noir…Et aussi avec Jean-Yves Escoffier,
le chef opérateur.
Mauvais Sang est très formel, peut-être un peu trop
esthétisant. Tout y est très dessiné, chaque chose a une place
très définie. Y compris dans sa couleur, car on ne peut pas
détacher une forme de sa matière.