| |
 |
|
|
Objectif
Cinéma : Quand vous débutiez,
quelle était la tendance dans le décor de cinéma ?
Ivan Maussion : J’ai commencé
à une période où on tournait beaucoup en décors naturels.
Les directeurs de production, qui étaient souvent jeunes,
avaient peur de mettre les pieds dans un studio. Ils en avaient
l’image d’une tradition, avec l’obligation d’acheter sur place
des matériaux chers, d’embaucher une grosse équipe avec de
nombreux assistants, un chef constructeur, etc. Pour eux,
le studio était synonyme de beaucoup de dépenses.
Grâce à certains décorateurs, dont j’espère faire partie,
on arrive de temps en temps à prouver le contraire aux productions
: qu’en studio on travaille mieux, on gagne du temps, donc
de l’argent.
Par exemple, il vaut mieux consacrer du temps à la préparation
du film sur le plan artistique que de passer des dizaines
d’heures en voiture à repérer des décors dans lesquels on
ne pourra pas faire ce que l’on veut. Et bien sûr, on maîtrise
mieux le son, la lumière, les acteurs sont dans de meilleures
conditions, etc.
J’aime le cinéma, les décors, et pour moi le studio est une
planète. A force d’expérience, je pense bien savoir tirer
parti du travail en studio, que ce soit dans la pub ou le
long-métrage.
Pour La veuve de St-Pierre, des amis ou des professionnels
m’ont demandé : « Alors, vous avez tourné entièrement
sur place ? ». En fait, les deux tiers du film
ont été tournés aux studios d’Arpajon où nous étions seuls
pendant plus de quatre mois, en occupant cinq plateaux. Patrice
Leconte interdit les reportages et les photos sur ses tournages
- pour lui, le décor doit exister à la sortie du film - si
bien que personne ne nous a vu. On y a tourné tous les intérieurs
et même la cour de la caserne sous la neige.
A St Pierre, on a fait les extérieurs, construit le café et
le village de pêcheurs. Et comme la neige n’a pas été au rendez-vous,
on a du le démonter entièrement - seize maisons pas prévues
pour être démontées ! - le transporter et le remonter
au Canada, à trois milles kilomètres de distance, tout ça
en une semaine…
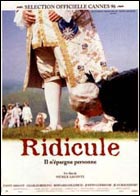 |
|
|
|
Objectif
Cinéma : Comme La veuve
de Saint-Pierre, Ridicule est un film d’époque, cette
fois la France du XVIIIème.
Ivan Maussion : On a reconstitué
cet univers : le XVIIIème, la cour de Versailles, dans
divers endroits de la région parisienne. Il a fallu bricoler,
c’est un mélange de studio et de décors naturels, de châteaux
qu’il a fallu aménager, remeubler.
Sur le grand plateau de Boulogne, qui est aujourd’hui détruit,
on a construit plusieurs intérieurs : la bibliothèque,
les bureaux du généalogiste, du gouverneur… et aussi une partie
de la salle de bal de Vaux-le-Vicomte car il fallait faire
des raccords après le tournage dans le vrai château. A Versailles
même, il n’y a qu’une seule scène dans le parc.
Il y avait une grande énergie artistique sur Ridicule,
et la lumière de Thierry Arbogast est pour beaucoup dans la
qualité finale. A la soirée des Césars, je suis parti avec
un César dans les mains, et Patrice aussi. J’étais vraiment
heureux pour lui, car il y a un consensus favorable sur ce
film, comme sur Le mari de la coiffeuse et Tandem.
Objectif Cinéma : Pour
la scène de repas entièrement éclairée à la bougie, comment
avez-vous travaillé le décor ?
Ivan Maussion : Pour cette
séquence du dîner, qui a duré deux jours entiers, la consigne
de Patrice était : pas un câble, pas une ampoule dans
ce décor. C’était éclairé uniquement à la lumière naturelle
de nuit : bougie et lampe à huile. J’étais d’accord
à 100%, cela donne une poésie supplémentaire. Pour le décor,
il fallait en mettre plus que dans la réalité : plus
de bougies bien entendu et plus d’éléments, plus de brillances,
plus d’ombres.
|