Objectif Cinéma :
Il a eu du mal à être sélectionné
dans les festivals…
Philippe Chapuis :
Entre Angers et Brest, il n’a été sélectionné nulle part effectivement…
On a fait au total 4 festivals en France avec Belfort et Vendôme.
D’autres courts-métrages en font entre 40 et 50 !
Il est très difficile de savoir comment faire pour être d’emblée
plus séduisant. Là, je ne savais pas trop à quoi le film allait
ressembler, même pendant le montage. Avant le dernier jour
de post-production, on ne pouvait pas savoir ce que à quoi
il ressemblerait. Finalement, ni la production ni moi ne regrettons
ce qui s’est passé : il n’a pas été sélectionné à Pantin
ou Clermont, mais il a été distribué par le GNCR, a été acheté
par Arte. Tout cela lui assure une visibilité qui récompense
nos efforts. Les gens pourront le voir.
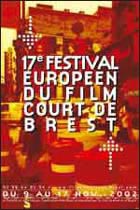 |
|
|
|
Objectif Cinéma :
Comment as-tu travaillé le son et la musique ?
Philippe Chapuis :
Beaucoup de choses se sont mises en place en parallèle.
Au moment où j’écrivais les toutes premières versions du
scénario, j’ai travaillé avec Jean-Marc Chauvel, le compositeur
de la musique du film, sur des films expérimentaux, musicaux,
dont il avait composé la musique ou emprunté d’autres musiques
d’autres compositeurs. On réalisait ensemble des films muets
avec la musique pour seule bande-son. Jean-Marc a beaucoup
travaillé sur des dispositifs mixtes. Celui qu’on a le mieux
réussi s’appelle De ma fenêtre. Il enregistrait des
sons depuis la fenêtre de son appartement et en a fait une
bande son, une sorte de condensé de l’univers sonore parisien,
pour laquelle il a composé ensuite une partition pour violoncelle.
Il a conçu cette dernière comme un dialogue entre le monde
extérieur, représenté par cette bande son, et l’être humain
représenté par ce violoncelle. Parfois le monde extérieur
couvre le violoncelle et d’autres fois le violoncelle reprend
ce qu’il a entendu dans le monde extérieur… A partir de
là, j’ai fait un film qui reprenait le même principe,
toutes les images venant aussi de cette fenêtre. On a joué
sur les échelles, les moments, et il est impossible d’imaginer
que ce film est fait du même point de vue. Jean-Marc m’a
fait découvrir le travail sur la matière sonore et l’idée
de musicalité du son. A quelques exceptions, le cinéma a
beaucoup tendance à être encore dans une conception de la
musique néoclassique de la musique. Par exemple dans Le
mépris ou In the mood for love, on retrouve des
thèmes très marquants qui reviennent, sont associés au film.
Je trouve au contraire que la musique et les images ne jouent
pas au même niveau de sensibilité. J’avais envie de lier
la perception sonore à la perception spatiale et mentale
et que tout concorde à la même impression. Quelqu’un m’a
d’ailleurs dit qu’il n’avait pas eu l’impression d’entendre
de la musique dans Antoine travaille, mais que tout
était lié. Il n’avait pas fait la différence sauf quand
il y avait un piano. Ce son lui avait paru naturel, ce qui
est quand même un comble car tout est complètement fabriqué !
Mais j’ai apprécié cette réaction car le but était véritablement
là : ne pas arrêter la perception mais faire en sorte
que cela nous plonge mieux encore plus facilement dans l’univers
du film.
Jean-Marc a recréé une bande sonore reconstituant les sons
de l’usine. L’idée était de dénaturer la bande son, de la
musicaliser, et à partir du même procédé, faire en sorte
que peu à peu, des sons de machine soient repris, au niveau
du rythme, par des instruments, que ces instruments soient
mimétiques, puis qu’ils se désolidarisent des sons d’origine
pour partir dans leur direction.
| |
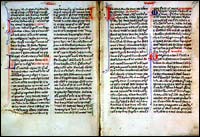 |
|
|
Certains sons sont présents sur
le début d’un plan, puis, alors que commence le travelling,
le son change, il est relayé par un deuxième son, puis par
un troisième. On a alors l’impression qu’il y a un point
de vue sonore, un point d’écoute qui change avec le point
de vue. A partir de la séquence du rêve, les sons des machines
se déréalisent, les pas d’Antoine sur le plancher métallique
deviennent les mouvements d’une machine, puis sa voix qui
compte dans son lit, puis le son de roues d’une autre machine,
etc. Il y a une métamorphose des motifs sonores, qui deviennent
de plus en plus musicaux. Jean-Marc a recréé par exemple
l’un des sons de machines, avec un bruit de porte en métal
de casier qui se ferme en couinant. Il l’a réutilisé, l’a
trafiqué pour faire un son de machine assez convaincant.
Il a composé la musique instrumentale à partir de De
natura rerum. Il voulait faire une musique des
atomes. Le son est un continent fascinant dont on a pas
encore épuisé toutes les ressources. Il y a aussi toute
la question des rapports entre le son et l’image et les
rapports entre la mémoire, la perception, et le son dans
la continuité du film. C’est une bande-son fine et subtile
qui n’arrête pas l’attention.