| |
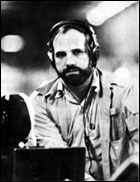 |
|
|
J’ai le sentiment qu’il existe une pureté
du cinéma que je n’ai jamais connue, que je découvre en retard
et que je ne retrouverai jamais. La cinéphilie, sans être
une activité dépressive, est une activité très mélancolique
car quand tu assistes à la projection d’un film que tu aimes,
tu assistes à la mort du film, à la mort de ce que tu ressens
par rapport au film. La cinéphilie consiste, de manière très
cruelle, à essayer de retrouver sans cesse en revoyant le
même film ou revoyant la même scène, une émotion originelle
qui n’existe plus. Après tu en trouves une autre, tu l’analyses
par exemple, ce qui te permet de compenser un peu le reste… Ce
sentiment irrigue complètement mon travail. Je n’ai pas
été marqué récemment par des images de cinéma, aussi fortes
que celles de Vertigo ou d’autres vues à 16 ou 17 ans.
Tout se passe à l’adolescence. Dans ce cas, la mise en abîme
est multiple car Vertigo parle de quelqu’un qui tombe
amoureux d’une image, plonge en elle comme il plonge dans
la baie de San Francisco. L’histoire de Vertigo, c’est
vraiment l’histoire de la cinéphilie : un type n’a pas
accès à une image sublime dont il tombe amoureux, il la voit
toujours de dos, de profil, n’a jamais accès à elle, et la
première fois où il va avoir accès à elle, il va la toucher
physiquement, en plongeant dans la baie de San Francisco (parce
que Madeleine plonge dans la baie). Il y a vraiment la notion
de plongée dans l’image, il passe du statut de spectateur
à celui d’acteur et il a le fantasme du cinéphile qui consiste
à être tellement happé par l’image qu’il envisage pourquoi
pas d’aller faire un tour « de l’autre côté ». Et
il perd ensuite l’image originelle devenue une image morte
qu’il va recréer : c’est le deuxième fantasme du cinéphile
qui veut revenir à l’image originelle en essayant d’imaginer
un temps enroulé sur lui-même. Le cinéphile veut non seulement
plonger dans l’image, mais aussi revenir toujours aux mêmes
images, il revoit toujours le même film pour retrouver le
film.
Vertigo est le premier film qui témoigne
de cela et je ne suis pas sûr que ce soit conscient de la
part d’Hitchcock. Ensuite, De Palma, consciemment ou non,
le ressent vraiment. J’avais fait pour Arte un sujet sur Vertigo
et La jetée, où je disais que Chris Marker était un
cinéaste un peu comparable à DePalma, que lui-même refaisait
Vertigo dans La Jetée en 1962. En 1982, il se
filme d’ailleurs lui-même sur tous les lieux de tournage de
Vertigo. Il ne refait pas seulement le film ni une
boucle dans le temps, il traverse l’Atlantique et va sur les
lieux du tournage. Il y a vraiment cette notion de traverser
le miroir, d’aller de l’autre côté, c’est quelque chose que
je trouve absolument passionnant. Vertigo est le fantôme
de mon travail cinéphile ; pas seulement le fantôme de
DePalma, mais le fantôme qui me fait m’identifier à la pulsion
cinéphilique, cette pulsion mélancolique de James Stewart
dans Vertigo, c’est-à-dire quelqu’un tombe amoureux
d’une image, qui arrive à passer de l’autre côté, qui la perd,
et qui va tout faire pour la retrouver, ce qui est la plus
belle définition de la cinéphilie. Une cinéphilie active,
un peu folle, qui croit en la puissance du cinéma. Ce n’est
pas forcément une idée très baroque.
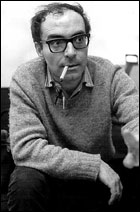 |
|
|
|
Objectif Cinéma :
Personnellement, j’ai découvert De Palma à la fac, pas comme
toi à la télé, à l’adolescence…
Luc Lagier : Moi,
tout s’est fait à l’adolescence. J’étais totalement accro
au cinéma d’horreur. Je ne connaissais pas vraiment le cinéma
français, à part Godard et un peu la Nouvelle Vague, mais
pas le jeune cinéma français. J’ai découvert beaucoup de choses
à l’Agence du court-métrage où j’étais d’abord objecteur de
conscience, et j’ai découvert surtout de nouvelles durées,
de nouveaux cinéastes et de nouvelles façons de faire du cinéma,
une façon différente de regarder les films, de les proposer
aux spectateurs, puisqu’il y avait plusieurs films dans un
même programme. Tout communiquait, ce n’était pas des films
hermétiques, une résonance se créait entre les spectateurs,
c’était formidable. Je m’intéresse aussi beaucoup au documentaire,
on y découvre d’autres formes de récits beaucoup plus larges,
plus souples.
|