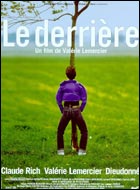 |
|
|
|
Objectif Cinéma : Qu'en
est-il donc de l'identification des scénaristes français ?
Claude Scasso : Premier
chiffre à noter : 95,2 % des réalisateurs participent au scénario.
C'est un pourcentage très élevé, notamment par rapport aux
pays anglo-saxons. Cela vient de la Nouvelle Vague, du poids
de la notion d'auteur en France. Il n'y a pas à le contester
ou à le regretter, c'est un état de fait qui ne changera pas
car c'est une composante de notre culture. En France, la population
des scénaristes professionnels est donc une population de
co-scénaristes. Seul aspect gênant de cette structure particulière
: la très grande difficulté rencontrée par les scénaristes
pour initier des films. Les scénaristes sont donc considérés
comme des techniciens. Leur apport artistique est peu utilisé,
ce qui est dommage.
Autre versant dans cette identification des scénaristes français
: le poids des occasionnels. Sur 913 contrats signés entre
1997 et 2000, 81 l'ont été par des personnes qui exercent
une activité principale autre que celle de scénariste. Et
c'est une fourchette basse, car j'exclus les romanciers, comédiens
et techniciens qui collaborent sur certains scénarios. Cette
donnée est quelque peu décourageante quand on sait que des
scénaristes confirmés ont du mal à trouver des films sur lesquels
collaborer. Tel scénariste perd ainsi sa valeur de métier,
de compagnonnage où l'on écrit avec ses pairs, où l'on apprend
sur le tas souvent à la télévision. Le dentiste devenu scénariste
par illumination est un phénomène rare. Même s'il y a toujours
des exceptions comme Gilles Taurand. Ces occasionnels peuvent
à la limite servir d'oreille attentive ou de punching-ball
au réalisateur, mais ils leur manquent la technicité, une
réflexion profonde sur ce qu'est le scénario. Je comprends
que Valérie Lemercier travaille avec sa sœur pour son film
Le Derrière, mais il ne faut pas s'étonner ensuite
que ce film soit inégal.
Objectif Cinéma : Pour
ce qui est des salaires ?
Claude Scasso : Comme
l'avait déjà montré le rapport Gassot, les questionnaires
montrent clairement qu'il n'y a pas assez d'argent pour le
développement des films. Dans certaines réponses de producteurs,
on voit bien qu'ils essaient de trouver le financement des
Sofica et des chaînes de télé et qu'une fois qu'ils les ont ;
ils se dépêchent de tourner, même si le scénario est imparfait.
Ils refusent de prendre six mois de plus pour par exemple
faire travailler un scénariste supplémentaire. Le développement
est donc le parent pauvre du cinéma français et les scénaristes
en pâtissent forcément puisqu'ils interviennent à cette étape.
| |
 |
|
|
Objectif Cinéma :
Les aides au développement du C.N.C sont insuffisantes ?
Claude Scasso : Elles
jouent un rôle et il y a eu un progrès notable dans ce domaine
depuis la sortie du rapport Gassot. Mais elles restent encore
très insuffisantes. Comme l'indique un chiffre qui n'est pas
dans l'étude et que j'ai trouvé sur le site de Ministère de
la Culture, sur le budget qui revient aux producteurs seulement
1 % est dévolu au développement. La France se trouve dans
le peloton de queue des pays européens. Dans certains pays,
le pourcentage dépasse les 10 %. Et puis dans les aides au
développement attribuées par le C.N.C, le système est vicié
du fait que 20 % de la somme est comptée comme frais généraux
du producteur et que sur le reste il faut encore compter différentes
dépenses comme les repérages. Il faut réduire le chiffre de
1 % pour avoir le chiffre réel de l'aide à l'écriture.
|