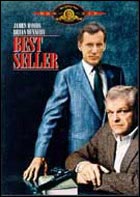 |
|
|
|
L’approche de Max Joubert
pour aborder l’archétype du flingueur est originale,
puisqu’elle obéit à une catégorisation
" corporatiste " : tuer est un
métier se plait-on à nous rappeler, et cette
figure hautement symbolique du cinéma populaire (d’après-guerre,
d’ailleurs, une particularité qui aurait peut-être
mérité un développement), est dégagée
par l’étude de ses différents " corps " :
le tueur à gage indépendant, le tueur affilié
à un gang…Cette partie est sans doute la plus aboutie
de l’ouvrage, même si elle se cantonne au cinéma
occidental. Et le parti pris pour le moins extrémiste
de Max Joubert (le flingueur) apparaît comme un type
efficace qui s’est rendu compte que flinguer faisait gagner
du temps, ce qui n’est pas complètement idiot. Il
est vrai que si tout le monde adoptait sa philosophie, il
y aurait beaucoup moins de glandeurs, d’incompétents
et de parasites. Mais bon, c’est pas bien de tuer. Faut
pas ". (p.14, sur A Bout Portant) a le
mérite d’assumer une fascination réelle pour
ce séduisant archétype. La méthode
comparative a ses mérites, et l'on appréciera
les mises au point, souvent justes, que Joubert effectue
sur quelques " classiques " intouchables
comme Le Samurai, Tueur d’Elite ou même
Pacte avec un Tueur de John Flynn (qui connut un succès
critique aussi éphémère qu’incompréhensible).
Se dégagent les figures tutélaires de Lee
Marvin (avec A Bout Portant et Point Blank de John
Boorman) et, plus original tout en étant justifié,
celle de Charles Bronson. Mais si le thème abordé
implique, par la pléthore de figures affiliées,
une sélection drastique, le choix de " liquider "
le cinéma de genre asiatique constitue une erreur
d’appréciation grave (d’autant plus lorsque le vaillant
Chow Yun-Fat est exhibé en couverture). Ainsi, le
capital La Marque du Tueur de Seijun Suzuki, au moins
aussi important que A Bout Portant de Don Siegel
en termes d’influence sur l’archétype de l’assassin
au sang froid, n’est-il cité qu’une seule fois, et
ne fait même pas l’objet d’une chronique.
Dès lors, l’ouvrage
donne le faux sentiment que le personnage du flingueur se
développe uniquement dans le cinéma hollywoodien
et français ; et ce n’est pas le tour d’horizon
sommaire - et un brin trop nationaliste - de tueurs " exotiques "
qui rééquilibre la balance. Au final, ce volume
est sans doute le plus bancal des ouvrages sortis, mais
les critiques qu’on peut lui faire pourraient s’appliquer,
à des degrés plus ou moins grands, aux autres.
On peut s’interroger en effet sur ces omissions qui oscillent
entre une sélectivité complaisante dans l’étude
des incontournables, et une certaine frilosité dans
la découverte d’incunables du genre. L’intérêt
premier d’une telle collection est de faire (re)découvrir
des films oubliés, pour de bonnes ou de mauvaises
raisons. Mais c’est ce que précisément se
refusent leurs auteurs, qui invoquent leurs droits à
la partialité. La limite est mince alors de " l’irrévérence "
à la désinvolture. Là encore, un équilibre
entre rigueur du traitement et un style divertissant reste
à trouver.
| |
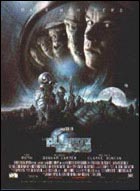 |
|
|
Ils sont velus, ils
sont tous là aborde un sujet rare, du moins dans
la littérature de genre en France : le personnage
du singe, de King Kong à Cheetah et jusqu'aux récentes
comédies pour enfants tel Mon ami Dodger. Malgré
un sommaire à la limite de l’ésotérisme,
où le lecteur est bien en peine de comprendre de
quoi il retourne (le chapitre sur Planet of the Apes
s’intitule ainsi " Charlton est Stone ",
sans commentaire), l’ouvrage de Régis Sajou se distingue
sans effort par son réel souci de construction, et
la maîtrise de son corpus. L’étude des
fondations de la figure du singe au cinéma est à
cet égard remarquable, dégageant la double
filiation de King Kong et des adaptations d’Edgar Allan
Poe. Cependant, il est parfois difficile de saisir les liens
possibles entre les films étudiés, dont seule
la présence de singes à l’image a déterminé
leur présence dans le texte.