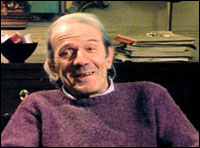 |
|
|
|
Le carcan thématique réfléchit et
proposé par Claire Parnet n’est bien sûr qu’un prétexte
à des digressions plus ou moins importantes, la possibilité
pour Deleuze de laisser divaguer son imagination, et de
donner à cet Abécédaire qui pouvait sembler rébarbatif un
ton souvent léger, et l’on apprend que Deleuze déteste les
chiens. Mais cette légèreté permet également d’aborder des
thèmes fondamentaux de la philosophie, et l’orateur délivre
quelques belles phrases : « la philosophie est
l’art du portrait », « penser, c’est être à l’écoute
de la vie ».
Si cet Abécédaire, et plus largement Deleuze et son œuvre,
sont si importants pour les cinéphiles que nous sommes,
c’est parce que le cinéma n’est jamais bien loin dans la
réflexion du philosophe. Comme nous, il aime Minelli et
les rêves dans lesquels il nous prend. Son Image-temps et
son Image-mouvement apparaissent soudain très clairs alors
qu’ils ont la réputation d’être ardus et difficile d’accès.
Les écrits de Deleuze les plus accessibles semblent bien
être ceux sur le cinéma, en regard de ce que disent les
apprentis philosophes et littérateurs, pour qui Deleuze
est un objet qui fait presque peur, en tous cas fatigant.
Ce que l’on comprend à moitié lorsque, arrivé à la lettre
K comme Kant, celui-ci expose les théories d’un autre philosophe
qu’il a longuement étudié une demi-heure durant.
SI le passage d’une lettre à une autre, et donc d’un thème
à un autre, s’effectue sans transition, et qu’il n’existe
pas de réelle progression dans la pensée comme dans le discours,
L’Abécédaire forme un tout bouclé sur lui-même. Souvent,
Deleuze revient sur des notions déjà abordées, nous prouvant
encore une fois que tout est dans tout, et que le dernier
est en fait le premier (à moins que le premier ne soit le
dernier ?), comme peut l’être le verre d’un alcoolique.
| |
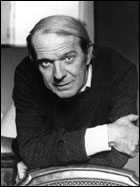 |
|
|
L’Abécédaire, jugé souvent austère
et sérieux, semble amuser celui qui sait être déjà mort
au moment où on le découvre sur l’écran. Il se prête au
filmage tout en faisant mine de l’ignorer, ou en tout cas
de ne pas se plier à une certaine tyrannie de la caméra.
On se fait piéger par le soi-disant naturel de celui qui
sait que ces images lui survivront, le représenteront après
que son corps ait disparu tandis que ces écrits seront toujours
vivants. Alors quelle image Claire Parnet et lui-même ont-ils
voulus donner ? Celle de celui pour qui « Ecrire
c’est propre, parler c’est sale » au moment même
où sa pensée est oralisée. Dans L’Abécédaire, la parole
dite est aussi problématique qu’elle est constituante du
dispositif : toutes les dix minutes, le penseur en
action est interrompu de force car il faut changer de bobine.
Cette contrainte technique devient un véritable élément
de mise en scène, et profère au film et à son sujet une
aura particulière : d’abord la frustration de voir
une pensée coupée en plein élan, et qui ne pourra plus jamais
être dite de la même façon, puisque improvisée et unique,
et puis une étrange sensation lorsque l’image disparaît
dans un voile blanc et que reste le son et la pensée qu’on
ne peut décemment pas couper. La voix plane alors que le
corps est déjà parti.