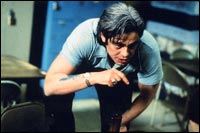 |
|
|
|
Le procédé utilisé n’est pas nouveau.
Elephant (2003) de Gus Van Sant développait déjà
de manière brillante cette écriture cinématographique. Dans
le film d’Iñarritu, cette technique est poussée à son extrême,
néanmoins sans que le résultat paraisse artificiel. Il n’y
a absolument aucune suite chronologique dans le récit.
La question que tout amateur de cinéma se pose alors est
: comment malgré cette non-narration le spectateur parvient-il
tout de même à suivre l’histoire, à en comprendre les tenants
et les aboutissants ? Tout simplement, je crois, parce que
ce procédé relève de la manière dont la mémoire humaine
fonctionne. Le réalisateur construit son film autour de
souvenirs, d’images brèves et uniques plutôt que de véritables
scènes de vie. Et ces images, qui appartiennent au passé
des personnages, ne se présentent pas forcément à leur cerveau
dans l’ordre dans lequel elles ont effectivement existé.
Par conséquent, je pense qu’Iñarritu place son film dans
une situation d’énonciation postérieure aux événements relatés.
Leur traumatisme subi par les différentes catégories de
personnages explique alors le choix fait par le réalisateur-monteur,
choix qui reste par ailleurs fort original, de construire
son film selon un principe de déconstruction du récit.
| |
 |
|
|
Pour ne pas perdre le spectateur,
Iñarritu articule cependant ses séquences grâce à des raccords
plus ou moins dissimulés. Ainsi, si un personnage prononce
le mot « verre » en fin de phrase, la séquence
suivante débutera par le geste d’un autre personnage prenant
un verre en main et le portant à sa bouche. Tout n’est donc
pas sans lien. Outre l’aspect technique de ce procédé, nous
pouvons également penser qu’il y a là une sorte de message.
Les faits, les gestes ne se répéteraient-ils pas ainsi indéfiniment
? La vie ne serait-elle pas un éternel recommencement ?
Le propos est peut-être exagéré, mais rien ne nous empêche
de croire que ces liens subtils d’un passage à un autre
ne sont pas sans signification.
Le film est en effet construit sur une interrogation essentielle
: pourquoi l’accident qui constitue le nœud dramatique du
récit a-t-il eu lieu ? Et pourquoi à cet endroit, à ce moment
précis, entraînant ainsi ces personnages-là ? Etait-ce prévu
? Un homme et ses deux petites filles meurent. Pourquoi
? Plusieurs solutions sont explorées par Iñarritu.
Simple (si tant est qu’on puisse employé ce mot) question
de malchance ? L’épouse et la mère qui perd en quelques
secondes la famille qu’elle avait fondée et construite jour
après jour peut le penser. Cela explique qu’elle sombre
alors dans la drogue, qu’elle n’ait plus goût à rien au
point de chercher désespérément la mort dans la poudre blanche.
La vie devient terne. Pâle. Les yeux rougis jusqu’à ce que
le cœur se dessèche et n’offre plus les larmes qui soulageaient
quelque peu.