| |
 |
|
|
Des films pour enfants,
Frédéric Back passe rapidement à des films tous publics et
son style s'affine, révélant parfois des influences de Chagall
(dans Illusion) ou des tonalités nettement impressionnistes
(dans L'Homme qui plantait des arbres). La beauté des
dessins donne également une plus grande portée à la fabuleuse
histoire d'Elzéar Bouffier et permet la création de plusieurs
arboretums aux quatre coins du monde. Suivant lui-même la
leçon d'humilité et de persévérance de son héros, Back a répété
25 000 fois ce geste de gratitude et de célébration de la
nature en plantant des arbres au Québec.
Avec le succès de ses films, Frédéric Back aurait pu décider
de créer une structure de plus grande ampleur, suivant ainsi
l'exemple de Walt Disney ou même du studio japonais Ghibli,
créé dans les années 1980 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata.
Mais il préfère continuer à travailler de façon artisanale
et passe souvent des journées entières seul dans son petit
bureau à Radio-Canada. «Pour moi, faire un film d'animation
c'est un peu comme écrire un livre. On oublie le monde et
l’on entre dans son univers. Dès que vous travaillez avec
quelqu'un d'autre, ça crée des préoccupations. Quand je suis
tout seul, je suis concentré, et si c'est mauvais, je jette
à la poubelle et je recommence. Mettre le travail des autres
à la poubelle, c'est tout de même plus délicat. »
Tout son art réside dans une sorte de minimalisme. «Je
ne tiens pas toujours à représenter les choses de façon trop
réaliste. C'est la partie en mouvement qui est importante
car l’œil se fixe sur ce qui est mobile. Moi, je cherche plutôt
à évoquer, et j'essaie aussi d'alterner entre la simplicité
et la profusion. Un bon film d'animation, c'est comme un concert
: on a besoin de moments de calme pour faire valoir toute
la beauté de l'instrument en solo. »
Le « Monsieur Animation » de Radio-Canada
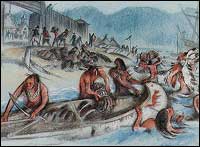 |
|
|
|
Comme disait Virginia Woolf,
tout artiste a besoin d'un lieu de tranquillité et d'indépendance
pour créer à son aise. Grâce à Radio-Canada, Frédéric Back
a pu développer son talent au sein d'une équipe, mais tous
les cinéastes d'animation n'ont pas la même chance. Pour remédier
à cet état de fait, la chaîne crée en 1970 un programme d'échange
avec des pays européens. Back se souvient que le projet permettait
à un pays qui avait produit un film d'animation d'acquérir
les films produits par tous les autres pays membres de l'échange.
Mais il prend fin en 1984, la production étant très inégale
et certains pays se sentant floués, explique un Frédéric Back
un peu nostalgique. «Le Canada a fait un travail énorme,
dit-il. On espérait qu'il y aurait une relève... »
Mais la relève ne vient pas et lorsque Back se décide à prendre
sa retraite en 1993, après son ultime réalisation Le Fleuve
aux grandes eaux (qui représente cinq ans de labeur et
près de 20 000 dessins), Radio-Canada se trouve privée de
son «Monsieur animation». La section animation de la chaîne
est alors sabordée et le seul moteur du cinéma d'animation
canadien reste l'ONF.
Bien qu'il ait dépassé l'âge de la retraite, Frédéric Back
dessine toujours sans répit, que ce soit des illustrations
de livres ou des collaborations pour des films. Après un ouvrage
sur les baleines en 1995, il a conçu les séquences d'animation
pour Mémoires de la terre, un documentaire de Jean
Lemire qui sera présenté début juin au Festival du film d'animation
d'Annecy. Pour les besoins du film, il est allé à la rencontre
du peuple Haïda, qui vit depuis plus de 10 000 ans sur les
îles de la Reine-Charlotte, au large de la côte ouest canadienne.
| |
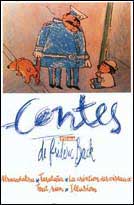 |
|
|
Tant qu'il y a une bonne
cause, le vieux missionnaire est toujours partant. Mais il
ne cache pas son aversion pour les dessins animés «d'un
goût douteux» qui envahissent les écrans de télévision
les mercredis matin. «C'est une façon très coûteuse de
tuer le temps des enfants, alors qu'ils ont beaucoup de potentiel
d'apprentissage. Je trouve ça assez destructif car ces films
créent le goût de la violence et n'ont aucune valeur au niveau
des réalités de la vie. »
Si les Japonais Miyazaki et Takahata citent Back parmi leurs
influences, ce dernier dit n'avoir « aucune affinité »
avec leur cinéma, qu'il trouve « extrêmement fouillé et
trop violent ». Il se reconnaît davantage dans les films
de ses amis Michel Ocelot (Kirikou et la sorcière,
primé à Annecy en 1998) ou Alexandre Petrov (Le vieil homme
et la mer, « oscarisé » en 2000) et valorise
le rôle didactique du cinéma plutôt que son aspect divertissant.
|