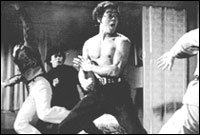 |
|
|
|
Mais pour en arriver à la star, il faudra
pour l’acteur en passer par une construction méthodique, dont
la programmation de l’Etrange Festival rendit visible les
principales étapes.
Tout d’abord, pour son premier rôle-titre de karatéka, Chiba
incarnera en 1973 un personnage issu d’une série de manga
à succès, Bodyguard Kiba. D’emblée, ce corps encore
maladroit de combattant de foire trouve une légitimité dans
un antécédent graphique, dans une forme héroïque stéréotypée.
Introduit dans l’univers cartoonesque et nationaliste, peuplé
de monstres humains ricanants, du film d’exploitation le plus
outré, c’est dans la grandiloquence que se définit d’emblée
la carrière future de Chiba. Sa première apparition l’impose :
lisant tranquillement son journal alors qu’une prise d’otages
se déroule autour de lui, figure encore anonyme de cadre en
costume trois pièce, c’est par la révélation de son visage
léonin et déjà crispé par une colère sans objet que le cinéaste
Tatsuichi Takamori identifie ce nouveau venu.
En effet, le visage grossier de Chiba, comme réfrénant constamment
une colère sourde, devient, plus que son aptitude réelle de
karateka, le motif clé de sa starification : les combats
brutaux qui parsèment Bodyguard Kiba n’ont pas la précision
chorégraphique des « kung fu » de Hong Kong, ni
même la précision des assauts du Chambara finissant.
L’arme à feu a autant, si ce n’est plus, sa place que les
poings dans ce mélange de polar yakuza et de film d’espionnage.
La mise en forme des combats recourt sans compter à des procédés
visant à asseoir son comédien aux yeux d’un spectateur pas
trop regardant au rang de super héros : effets de montage
et emphase emprunté au « kung-fu » (trampoline compris)
y sont la norme. Dans une course à l’outrance sanglante déjà
bien entamé par la série des Baby Cart (elle-même adapté
d’un manga), Bodyguard Kiba fait au moins aussi saignant.
A noter pour l’anecdote que Chiba inaugure ici une série de
« casseur de membres » qui trouvera son glorieux
représentant, quelques dizaines d’années plus tard, en la
personne de Steven Seagal.
| |
 |
|
|
Un autre élément capital du personnage est
son amoralité. Prenant place dans un Japon urbain montré comme
gangréné par la corruption, la starification de Chiba lui
offre le paradoxe d’incarner à la fois une tradition martiale
centenaire, le karaté, et de revendiquer l’amoralité du bussinessman
conquérant : il est un ronin (samurai sans maître) moderne,
sans la mélancolie morbide qui fait le prix de cet archétype.
Attaché à suivre son ambition (fonder un dojo) par tous les
moyens, Chiba est un homme d’affaire aux méthodes violentes :
cette volonté forcené de succès, peut-être l’aspect le plus
déplaisant du mythe, s’inscrit cependant pleinement dans le
Japon des années 70, ébranlé par la contestation et le terrorisme.
En guise de clin d’œil, la première séquence voit ainsi Chiba
régler à coup de poing un détournement d’avion, spécialité
des terroristes japonais de l’époque.
On signalera que Chiba a débuté sa carrière sous les auspices
de Kinjj Fukusaku : sans surestimer l’influence de ce
cinéaste, son univers de marginaux condamnés à la violence
sans recours par la pression d’un contexte social impitoyable
n’est pas étranger au personnage Chiba, qui en constitue la
version dépolitisée.
|