Un travail de dentellière
| |
 |
|
|
Malgré sa célébrité en Russie, Staréwitch
devait refaire ses classes comme opérateur en France avant
de pouvoir repasser à la réalisation. Il a préféré revenir
à ses premières amours : l’animation. “ Je crois
que c’était une façon de garder son indépendance dans des
conditions assez artisanales où il était le seul maître d’œuvre ”,
explique Kawa-Topor. Enfin pas tout à fait seul : Anna,
la femme de Ladislas, cousait les costumes, sa fille aînée
Irène l’assistait dans les prises de vues et les négociations
de contrats, et sa fille cadette Jeanne, dite Nina Star, jouait
dans la plupart de ses films (avec les marionnettes bien sûr).
Ladislas Staréwitch menait presque tout le reste : écriture
des scénarii, fabrication et animation des marionnettes, réalisation
et montage des films.
La maison de Staréwitch, vendue en 1993 par sa petite-fille,
était le dernier studio de Fontenay. C’est là que le cinéaste,
qui était aussi bien un artisan qu’un artiste, travaillait
avec une minutie et un dévouement inimaginables aujourd’hui :
quand on se souvient que Staréwitch devait modifier la position
de ses marionnettes 24 fois pour obtenir une seconde de film,
il y a de quoi rester pantois. Ce travail énorme faisait pourtant
partie de la vie quotidienne du pionnier de l’animation. “ J’ai
le souvenir d’un homme qui travaillait toujours, sauf les
derniers mois de sa vie ”, confie sa petite-fille.
“ Il avait des idées sans arrêt, et faisait des films
pour se faire plaisir : la Petite chanteuse des rues, c’était
le genre de films qu’il faisait pour Noël, pour projeter à
la maison. ”
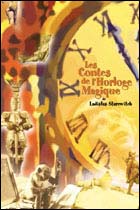 |
|
|
|
La Petite chanteuse des rues,
interprétée par Nina Star et un petit singe animé, a été
choisie pour ouvrir la trilogie des Contes de l’Horloge
grâce à ses qualités musicales. L’histoire est
celle d’une petite fille qui chante avec son limonaire pour
aider sa mère à racheter la maison familiale. Loin d’être
misérabiliste à la Dickens, le film met en valeur la débrouillardise
de la fillette et fait preuve d’une gaieté et d’une candeur
rafraîchissantes.
Le thème du limonaire introduit dans ce film a inspiré la
dramaturgie musicale, fournissant le rythme de valse qui
lie les trois courts métrages. “ Ses films ont un
rythme tel qu’il est évident que Staréwitch aimait la musique.
Sans arrêt, il convoque la musique, sur les regards, les
gestes, la danse ”, s’exclame Jean-Marie Sénia,
compositeur de la musique originale et accompagnateur de
films muets. “ Staréwitch vous oblige à effectuer
un travail de dentellière, sinon on peut rater des détails.
Il faut être aussi obsessionnel, aussi perfectionniste que
lui. ”
Staréwitch appliquait la même discipline à ses marionnettes,
qui se pliaient à son bon vouloir plus facilement que les
actrices de l’époque. “ Il disait : “ Les
marionnettes arrivent à l’heure, elles ne font pas de caprices,
on n’a pas à leur donner un cachet et elles font tout ce
que je veux. ”, raconte Béatrice. “ Quoique
des fois, les marionnettes lui ont joué des tours et il
disait : “ Celle-là, elle nous a déçus. ”
Ou alors : “ Celle-là, on ne s’attendait pas à
ce qu’elle donne toute cette vie ”.
La transformation de marionnettes de bois en véritables
personnages s’opère en effet comme par magie, grâce à la
subtilité de l’animation et aux qualités de conteur de Staréwitch.
La technique, si bien maîtrisée qu’elle passe inaperçue,
ne perturbe pas l’attention du spectateur qui peut se plonger
dans le monde de la fable et rire des travers des hommes
transposés dans l’univers animal et végétal. “ Comme
La Fontaine, il sait voir les travers des hommes, mais il
nous les montre sans les juger ”, remarque Jean-Marie
Sénia. “ Il ne condamne pas l’humain, il le regarde
vivre. En bon entomologiste, il regarde les êtres humains
comme des scarabées. ”