POLAR, MELO, ET BIOPIC
Le cinéma allemand
connaît depuis quelques années un certain renouveau,
avec la mise en chantier régulière de films
aux budgets conséquents, se rattachant à un
cinéma de genre, avec une prédilection pour
le polar et le film historique, du moins dans ses composantes
les plus spectaculaires.
Si on se souvient sur les
écrans français de la crinière rousse
de la jolie Famke Potente dans la comédie à
suspense Cours Lola, Cours, le fait est incontestable :
l’Allemagne est sous-représentée sur les écrans
français - au même d’ailleurs titre que la Grande-Bretagne,
ou encore l’Italie. Cependant, le statut de " cinéma
populaire de qualité " d’une frange de la
production allemande offre à priori des qualités
facilitant une exportation possible, au moins autant en tout
cas que les mélodrames Bollywoodiens que des distributeurs
facétieux lancèrent sur le marché français.
En matière de cinéma, l’Union Européenne
est loin d’être réalisé. Il est ainsi
étrange de découvrir ces films dans le cadre
d’un festival alors que leur " proximité "
pour un spectateur français de leur préoccupation
et leur manière de les énoncer encourage une
réflexion possible sur un cinéma " européen ".
C’est dès lors tout l’intérêt du festival
du cinéma allemand, dont l’année 2002 marque
la 7e édition, que de s’offrir en vitrine
des productions de l’année : une mission guère
médiatisée mais au succès constant, qui
a le grand mérite de donner à voir des nouvelles
fraîches d’une cinématographie voisine.
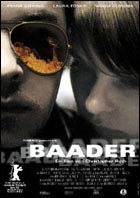 |
|
|
|
Comme l’an dernier, le film
historique est toujours présent en masse dans la sélection
du festival. " Historique " est d’ailleurs
ici à entendre dans le sens d’un contexte dépaysant,
plutôt que d’une interrogation véritable des
fondements de notre présent : ainsi les Frères
Sass (Carlo Rola, 2001), ou Une enfance africaine (Caroline
Link), prenant comme décor respectivement le Berlin
des années folles précédant le nazisme,
et une Afrique fantasmée par une fillette juive en
exil, n’interroge à aucun moment la complexité
de leur diégèse, et n’en passe pas non plus
par la forme du film à thèse ou " à
message " : l’Histoire s’offre en toile de
fond de films d’aventure picaresque (Les Frères
Sass), ou d’une chronique de l’enfance emplie de chromos
nostalgiques (Une Enfance Africaine). Le temps n’est
pas (n’est plus ?) pour les cinéastes allemands
à l’interrogation du sens de l’histoire ; déjà
le film récompensé l’an dernier par le Prix
du Public, Aussi Loin que mes pas me portent, put faire
tiquer nombre de spectateurs pour ces quelques scènes
d’une nostalgie pour le moins incongrue pour l’Allemagne des
années 40 : des images impensables il y a encore
une dizaine d’années. Ces films, productions de prestige,
s’avèrent ainsi passionnants pour qui veut se confronter
au rapport qu’entretient l’Europe contemporaine à son
passé plus ou moins proche.
Outre la sélection contemporaine, cette 7e
édition proposait un double hommage aux deux Femmes
Fatales du cinéma allemand, Hildegard Knef et Marlene
Dietrich, celle qui resta et celle qui s’exila. Une mise en
parallèle judicieuse qui permit de découvrir
des films-clés de Knef, actrice relativement méconnue
hors des frontières de l’Allemagne, tels Confession
d’une Pêcheresse (Die Sunderin, 1950) de
Wili Forst, ou Sous les Ponts (Unter den Brucken
1944) d’Helmut Kautner, peut-être " l’un des
plus beaux films d’amour du cinéma allemand ".
De cette sélection, nous nous attarderons sur deux
films qui, malgré leurs imperfections, se distinguent
par leurs volontés d’audace formelle.
|